PAGE d’ACCUEIL
du SITE de FRANCOIS-XAVIER BIBERT
Voir aussi
les pages consacrées à :
La généalogie des
CHEDEVILLE autour de Chartres et
des anciens vignerons du département
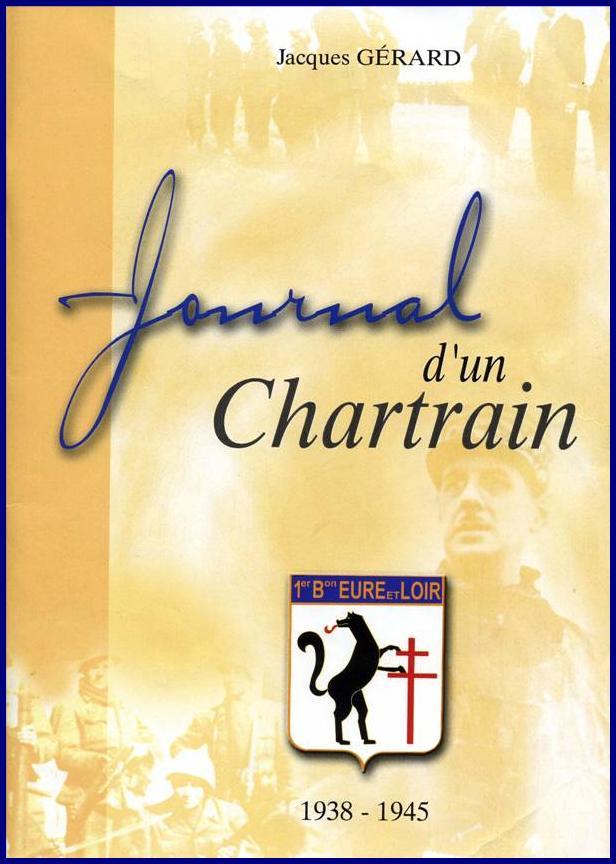
Jean pierre Gorges
Hommage
aux Volontaires
Du 1er
Bataillon de l’Eure et Loir
Il y a 60
ans, le 14 juillet 1945, les Français fêtaient la paix retrouvée, même si des
soldats français combattaient encore les Japonais dans le pacifique et la mer
de Chine.
La métropole
comptait ses morts en relevant ses ruines. L'état de droit lui aussi commençait
à reprendre ses marques. Mais privations et rationnement continuaient. Le
redressement n'en était qu'à ses balbutiements.
76, me
dit-on, sont encore en vie. C'est pour les honorer que la Municipalité de
Chartres a voulu éditer les souvenirs de Jacques Gérard, un chartrain qui fut
l'un des leurs. Avec la retenue qui sied à ceux qui ont vraiment « fait la
guerre », il raconte ses aventures et celles de ses camarades, plongés dans la
tourmente. Il le dit simplement, avec l'émotion retrouvée de ses 20 ans. Il
tient seulement à inscrire cette épopée discrète dans la grande geste des
Français qui s'engagèrent « pour la durée de la guerre ». Et pour la liberté de
notre pays. On les appelait les « volontaires » du 1er Bataillon de
l'Eure-et-Loir.
Qu'ils
soient ici remerciés.
Jean-Pierre GORGES
Député-Maire de Chartres
Juillet 2005
Journal
d'un Chartrain
1938-1945
Rédigé
par un de nos camarades, évoquant la mémoire des années sombres vécues par nos
concitoyens mais qui rappelle aussi la naissance de la résistance, ses martyrs,
ses combats, ses actions, qui nous conduiront à la libération du territoire
national, aux côtés des armées alliées, avec l'honneur d'accueillir le général
de Gaulle à Chartres (23/08/44) et la joie de participer à la libération de la
capitale. (25/08/44).
M.
Raymond MARCHAND
Président
de l'Amicale des Anciens
du 1er
Bataillon d'Eure-et-Loir
RESISTANCE
Quand nos armées vaincues abandonnèrent Paris
Jacques GERARD
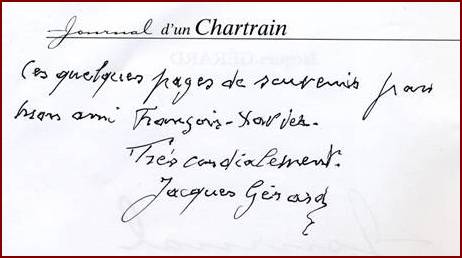
Cette
page a été réalisée par François Xavier BIBERT avec l’autorisation de
l’auteur Jacques GERARD et de la municipalité de Chartres. Le recueil
original, dont la couverture est reproduite ci-dessus, a été publié par la
ville de Chartres en 2005. Il a été tiré à 1000 exemplaires qui ont été
distribués gratuitement.
JOURNAL d’un CHARTRAIN
par Jacques Gérard ©
2005
Cliquez sur les photographies pour les
agrandir
Je voudrais, ici, relater très simplement et suivant
les caprices de ma mémoire quelques souvenirs personnels de la période si troublée
et si riche en événements historiques de la guerre 1939-1945, tels que je les
ai vécus. N'ayant pris que quelques notes pendant cette longue durée, je dois
dire que si les faits et événements évoqués sont exacts, il n'en sera pas de
même pour les dates qui pourraient être l'objet de certaines erreurs.
Je diviserai ce récit en deux parties :
La 1ère partie débutera en septembre 1938
pour se terminer le 21 août 1944. Cette date marquant la libération de la ville
de Chartres.
La 2ème partie débutera le 21 août 1944 pour se
terminer le 23 mai 1945.
1ère partie
Septembre 1938 - 21 août 1944
Nous sommes à Chartres au mois de septembre 1938. A ce
moment, et depuis plusieurs années déjà, notamment depuis l'annexion de l'Autriche
par l'Allemagne Nazie, la menace Hitlérienne se fait de plus en plus précise. A
l'occasion de l'affaire des Sudètes, il semble bien, pour tout esprit lucide,
qu'Hitler est plus que jamais décidé de poursuivre envers et sa politique
d'expansion et de domination de l'Europe. Je suis alors âgé de quinze ans et
demi, et, en cette fin de vacances toute la famille reçoit comme un choc, la
triste nouvelle du rappel sous les drapeaux de mon père en tant qu'officier de
réserve. Son absence ne devait durer que quelques semaines, car à ce moment
interviennent les accords de Munich qui devaient se révéler si néfastes par la
suite. La menace de guerre étant provisoirement écartée, les réservistes
rentrent dans leurs familles dans une atmosphère lourde de menaces. L'année se
déroule sans incidents apparents mais dans une ambiance de crainte sinon
d'attente de plus graves événements. L'automne approche puis le 1er
septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Par le jeu des alliances, la
Grande-Bretagne puis la France lui déclarent la guerre.
Quelques jours avant cette date historique, mon père
est à nouveau rappelé, malgré ses charges de famille, à rejoindre son unité.
C'est, bien sûr, la tristesse, la désolation à la maison. Pour faire face, le
mieux possible à cette situation, il m'informe de la nécessité pour moi de
quitter le lycée où je devais rentrer en première et de commencer à la
charcuterie, l'apprentissage du métier. Ma sœur Jacqueline se voit
attribuer les mêmes fonctions pour aider notre mère. Je dois dire que nous nous
efforçons de remplir le mieux possible ces tâches si nouvelles pour nous. Mon
grand-père, malgré son âge et sa fatigue, se voit confier la marche du
laboratoire.
 La
Charcuterie MARCHAND à Chartres en 1924, « Gibiers et Volailles, Escargots
de Bourgogne » juste après la naissance de Jacques GÉRARD. Sur cette
photo, sa mère Germaine (née MARCHAND en 1902) et son père Armand (né en 1896),
ainsi que son grand-père Maurice MARCHAND (né en 1873au Coudray) qui
s’associa en 1923 avec son futur gendre, fils d’un charcutier renommé
de Compiègne, pour fonder ce commerce prestigieux. L’établissement était
situé à gauche en entrant dans la rue Delacroix à partir de la place des Épars.
C’est maintenant un magasin de lingerie ! Armand GÉRARD,
contrairement à la légende, n’a pas « inventé » le « Pâté
de Chartres » vieux de 500 ans, mais ils a contribué à le relancer entre
1925 et 1939, en le rendant populaire auprès de la population chartraine...
La
Charcuterie MARCHAND à Chartres en 1924, « Gibiers et Volailles, Escargots
de Bourgogne » juste après la naissance de Jacques GÉRARD. Sur cette
photo, sa mère Germaine (née MARCHAND en 1902) et son père Armand (né en 1896),
ainsi que son grand-père Maurice MARCHAND (né en 1873au Coudray) qui
s’associa en 1923 avec son futur gendre, fils d’un charcutier renommé
de Compiègne, pour fonder ce commerce prestigieux. L’établissement était
situé à gauche en entrant dans la rue Delacroix à partir de la place des Épars.
C’est maintenant un magasin de lingerie ! Armand GÉRARD,
contrairement à la légende, n’a pas « inventé » le « Pâté
de Chartres » vieux de 500 ans, mais ils a contribué à le relancer entre
1925 et 1939, en le rendant populaire auprès de la population chartraine...
A cette époque, le commerce connaissait la même
activité qu'avant la guerre. Le travail ne manquait pas, le ravitaillement se
faisant normalement. Mon père, aussitôt son rappel sous les drapeaux, eut la
chance si l'on peut dire, d'être affecté à Compiègne qui était sa ville natale.
Il avait ainsi l'occasion d'aller passer ses moments libres auprès d'André
Lerouge, son ami d'enfance et de collège. Cet heureux hasard adoucira quelque
peu la peine qu'il avait d'être éloigné des siens.
En tant que lieutenant, il sera affecté au
commandement d'un important dépôt d'essence situé à quelques kilomètres de la
ville. Compiègne étant située dans la zone des armées, nous parviendrons à
aller le voir en nous munissant de laissez-passer obligatoires. Les mois
passaient lentement, 'était ainsi qu'on
le disait alors « La drôle de guerre » avec la stagnation quasi totale sur le
front où la présence de l'ennemi se manifestait seulement par des activités de
patrouille. L'hiver 39-40 fut rude, froid et neige, le pain et le vin gelaient,
paraît-il, sur la ligne de front.
Au début du printemps intervint un décret suivant
lequel les officiers de réserve ayant charge de famille se verraient affectés à
de nouveaux postes dans la zone des armées. Mon père fut alors désigné pour
commander un important dépôt de munitions à Châteaudun. Toute la famille se
réjouit de cette bonne nouvelle car nous pourrions ainsi le voir plus souvent.
Le mois de mai approche et, c'est à la surprise
générale, du moins pour les civils, l'imparable coup de boutoir, le 10 mai, de l'armée
allemande. Ses divisions blindées, appuyées par une aviation tactique
redoutable enfoncent le front français qui ne sera jamais rétabli. A noter
cependant une contre-attaque de chars montée par un certain Colonel de Gaulle à
Moncornet dans l'Aisne. L'armée ennemie déferle sur le pays. La Seine est
atteinte. Paris est pris sans combat, ayant été déclaré « Ville ouverte ». Les
bombardements aériens menacent notre ville. Nous voyons une dernière fois notre
père qui nous enjoint avec détermination de nous débrouiller seuls, lui, devant
ainsi qu'il est de son devoir, retourner à son poste auprès de ses soldats.
Ma mère, mon grand-père, ma grand-mère décident alors
que nous devons quitter la ville. Moulins, où résident nos cousins Baranez, est
la destination choisie. Le 17 juin après le déjeuner, nous quittons la ville
sous un bombardement. Avec l'aide de mon grand-père, j'ai réussi non sans
peine, la veille du départ, à entasser dans nos deux voitures, bagages et
objets de toute sorte et arrimer avec des cordes un matelas sur chacun de nos
deux véhicules. Puis le convoi ainsi chargé, après embarquement de la famille,
prit la direction d'Orléans. Je suis au volant de la Citroën Traction avant de
mon père. Mon grand-père conduisant sa petite Fia. Au fur et à mesure que se
déroule notre voyage, les routes sont de plus en plus encombrées par les
convois de réfugiés et nous voici obligatoirement déviés en direction de
Beaugency.
Le soir venu, non loin de cette ville, nous faisons
halte à l'orée d'un bois et, après nous être restaurés avec les provisions de
bord, nous passons la nuit à la belle étoile par un temps heureusement clément.
Le lendemain matin, c'est le départ vers Beaugency pour tenter de franchir la
Loire. L'encombrement des routes qui donnent accès au fleuve est alors à son
comble. Nous suivons une route parallèle au cours d'eau. Il nous fallut 24
heures pour atteindre le pont de Sully, distant seulement de 10 kilomètres.
Il régnait sur la route une pagaille indescriptible.
Le flot des réfugiés étant intimement mêlé aux éléments disparates de l'armée
en retraite. C'était un spectacle lamentable et affligeant car nous pouvions
voir, hélas, des officiers français qui, ayant abandonné leur poste, fuyaient
avec leur famille. Un officier français de race noire s'efforçait sans succès
de rassembler les fuyards. A ce moment, nous pensions avec fierté à notre père
qui, lui faisait son devoir et gardait ainsi la responsabilité de son
commandement. L'aviation adverse cherchait à bombarder le pont et la nuit s'illuminait
des fusées éclairantes tirées par l'ennemi. Vers midi, enfin, nous parviendrons
à franchir le fleuve en direction d'Argent sur Sauldre. La colonne
ininterrompue de civils et de militaires mêlés emprunta une route bordée de
tilleuls, mais à peine avions nous parcouru quelques centaines de mètres que
l'aviation ennemie, de « courageux » italiens, paraît-il, fondaient sur nous en
rase-mottes et nous faisaient subir un violent mitraillage. Nous abandonnons
alors nos véhicules et nous nous jetons dans les fossés. Cette chaude alerte
passée, nous regagnons nos voitures. Par une chance inouïe toute la famille se
retrouva au grand complet sans la moindre égratignure. Survint alors un
incident : une roue arrière de la Citroën était crevée. Le pneu, ainsi que nous
le constaterons par la suite, ayant été perforé par une balle de gros calibre.
Un soldat m'aida à changer la roue.
 Le
Général de Gaulle pendant la bataille de France
Le
Général de Gaulle pendant la bataille de France
Après avoir traversé Argent où nous prenons notre repas
sur une table sale dans une usine abandonnée, notre convoi poursuivit sa route
sans problème majeur. Ce périple se terminera dans un petit bois tranquille aux
environs d'Enrichemont sur Cher. Après une nuit passée à la belle étoile, des
fermiers secourables prirent pitié de nous et eurent la gentillesse de nous
héberger dans leur grange à foin. La famille trouvera à cet endroit un refuge
relativement sûr et confortable. Quelques jours plus tard couraient des bruits
d'armistice qui allaient d'ailleurs se préciser par la suite. Puis, ayant eut
la confirmation de ce triste événement, la famille se rendit à Enrichemont pour
examiner de près la situation et chercher quelque ravitaillement. Là, sur la
place principale, nous subissons un choc douloureux : une importante unité de
l'armée allemande en bonne tenue et en bon ordre était en train d'établir son
bivouac. Ces uniformes « Feldgrau » que nous voyons pour la première fois nous
causèrent une grande tristesse car cette présence concrétisait la défaite de notre
armée et l'occupation de notre pays. De retour à la ferme, nos parents
décidèrent de tenter le voyage de retour malgré le peu d'essence restant dans
nos réservoirs. Les deux voitures prirent, par de petites routes, la direction
d'Orléans où nous devions franchir la Loire sur le pont de Vierzon. Ce pont
destiné au chemin de fer avait été provisoirement converti en pont routier par
le génie allemand, les deux autres ponts franchissant le fleuve ayant sauté. A
ce moment la petite Fiat de mon grand-père tomba en panne d'essence. Je parvins
à la prendre en remorque derrière la Citroën. De cette façon nous atteindrons
avec difficultés la ville d'Orléans.
Notre pauvre convoi va trouver refuge dans une rue
calme non loin du centre, et là, le soir tombant, la famille prendra un repas
sommaire avec les provisions restantes et se préparera à passer la nuit dans la
rue. Voyant notre situation précaire, un homme âgé, habitant seul une maison
voisine, décida très gentiment de nous offrir l'hospitalité. Le lendemain matin
quelle ne fut pas notre surprise de constater que la voiture de mon grand-père
avait disparu avec tous les bagages qu'elle contenait. Nous devions rester
plusieurs jours chez ce brave homme n'ayant plus une seule goutte d'essence.
Après avoir fait d'interminables queues à la mairie, nos « bienveillants »
occupants nous en délivrèrent 10 litres. Puis entassés tant bien que mal dans
la Citroën, la famille regagna Chartres à vitesse réduite pour économiser le
précieux carburant.
Ayant omis de le préciser au début de ce récit, je
voudrais indiquer que notre famille se composait de ma mère, mon grand-père, ma
grand-mère, de mes quatre frères et sœurs et de moi-même. Mon frère cadet
Jean-Claude n'étant âgé que de sept ans. En arrivant dans notre ville, nous trouverons
nos deux maisons pillées et passablement dévastées. Il fallait, alors, faire
l'impossible pour ouvrir à nouveau la charcuterie et aider ainsi au
ravitaillement de la population. Ce fut, chose relativement facile, au moins
les premiers mois car a viande de porc ne manquait pas. Cela devait s'aggraver
considérablement par la suite. Quelques jours après notre retour, nous
apprenions l'attitude de notre préfet Jean Moulin qui, voulant résister aux
allemands, avait courageusement subit leurs sévices et leurs tortures sans pour
autant céder au chantage de l'ennemi. La ville était occupée par de nombreuses
troupes, notamment des aviateurs qui allaient utiliser le terrain d'aviation
comme base de départ pour des raids meurtriers contre l'Angleterre.
Les grands hôtels de la place des Epars étaient
occupés et transformés en « Kommandantur ». Le couvre-feu était imposé par les
occupants. C'était le début d'une longue et douloureuse période qui allait
devenir de plus en plus dramatique et dangereuse.
Comme la plupart des français, je n'avais pas entendu
l'appel du 18 juin. C'est un charmant garçon qui travaillait avec moi à la
charcuterie qui m'apprit l'existence et l'action d'un certain général de
Gaulle. Ce général avait refusé la défaite et dénoncé l'Armistice de Pétain.
Réfugié à Londres, il avait décidé de continuer la lutte aux côtés des
britanniques. Selon ses renseignements, cet ami m'indiqua que la radio anglaise
diffusait chaque jour des émissions en français sur ce mouvement dirigé par de
Gaulle et qui s'intitulait « La France Libre ». Cette idée que certains
refusaient la défaite nous enthousiasma. Enfin, un soir, après pas mal de
difficultés, à l'aide de nos postes à lampes de l'époque, nous parvenons à
capter ces émissions malgré un brouillage intense produit par l'ennemi. A
partir de ce moment, cette activité clandestine et réprimée, occupera toutes
nos soirées, car de Londres, nous parvenait l'espoir. Après de longues semaines
sans nouvelles de mon père, nous eûmes la joie de le voir arriver, fatigué mais
sain et sauf. Au moment de l'avance de l'armée allemande, il s'était, par
ordre, replié vers le sud ayant le commandement mais aussi la charge de trois
compagnies, soit près de 300 hommes. Il les conduisit à marche forcée au delà
de la ligne de démarcation sans qu'aucun ne fut blessé ni prisonnier. Cette
action qui s'ajoutait à ses états de service pendant la guerre 14-18 lui valut,
en plus de la croix de guerre avec étoile gagnée à Verdun d'être promu
chevalier de la légion d'honneur.
Peu de temps après son retour, les allemands, pour y
loger des aviateurs, décidaient de réquisitionner notre belle maison de la rue
du Grand Faubourg. Ce fut au sein de notre famille, la consternation mais aussi
la rage d'être dépossédés par l'ennemi. Notre départ se fera dans la plus
grande dignité.
Les mois passaient lentement, il faut le dire, à cause
de l'obsédante présence des troupes d'occupation et des contraintes qui nous
étaient imposées. Le ravitaillement devenait de plus en plus précaire et un
rigoureux système de rationnement fut institué. Il n'est pas exagéré de dire
que, pendant ces quatre années d'occupation les allemands pillèrent et affamèrent
littéralement la France.
Je dirai, ici, à titre d'exemple que la ration de pain
quotidienne était de 250 à 300 grammes par jour.
La population recevait en outre 50 grammes de mauvaise
charcuterie par semaine... L'hiver 40-41 fut rigoureux et très neigeux. Les
distributions de charbon étaient extrêmement rares et en très petites
quantités. Nous parvenions de temps en temps à nous procurer quelques stères de
bois que nous devions transporter dans un camion à gazogène. La sciure et
parfois le coke étaient également utilisés pour garnir la chaudière. Au
printemps 1941, un grand événement allait à nouveau faire basculer le cours de
la guerre : l'Allemagne Nazie attaquait la Russie. Comme chacun le sait, leurs
armées progressèrent au début de la campagne d'une façon foudroyante dans ces
immenses territoires. Mais le redoutable hiver russe arriva sans que les
envahisseurs parviennent à prendre Moscou.
Leur avance se trouva bloquée par une puissante contre-offensive
de l'armée rouge à seulement une trentaine de kilomètres de la ville. Ce fut,
peu à peu, et au cours de longs mois d'hiver, l'enlisement de la Wehrmacht dont
le glas fut sonné par la suite lors de la terrible défaite de Stalingrad. Les nouvelles
de cet important front de guerre nous parvenaient de Londres, malgré un intense
brouillage, car il n'était pas, bien sûr, question de se fier aux informations
des radios dites françaises entièrement contrôlées par l'ennemi.
Pour suivre les opérations militaires sur le front
russe, nous avions fixé sur le mur de la salle à manger une grande carte de
l'U.R.S.S. sur laquelle nous tracions chaque jour la ligne de front à l'aide
d'épingles et de laine rouge. L'Angleterre malgré les terribles raids de la Luftwaffe,
tenait bon, soutenue par l'invincible Churchill. Cependant les nouvelles de la
guerre n'étaient pas bonnes. Les sous-marins allemands coulaient dans
l'atlantique de très nombreux navires destinés au ravitaillement des
britanniques. Ces derniers aux prises avec les japonais dans le sud de l'Asie,
subissaient de graves revers aussi bien sur terre que sur mer. Au mois de mai,
mon cousin Yves, craignant d'être inquiété par les allemands vint se réfugier à
Chartres au sein de notre famille. Ce fut pour moi une grande joie car nous
partagions tous deux les mêmes convictions gaullistes et la même certitude de
la victoire finale sur l'Allemagne Nazie. Peu de temps après son arrivée nous
eûmes l'idée de rechercher un contact avec un mouvement de résistance pour
essayer de faire quelque chose d'utile. Mais ce ne fut que déception car, dans
la ville, même, il ne semblait pas qu'il y eut de groupe vraiment organisé.
Notre rôle fut bien modeste, il se limita à la distribution de quelques tracts
d'obédience communiste d'ailleurs. Nous devions cependant par la suite
effectuer en plein jour un transport d'armes qui devait se révéler aussi
dangereux qu'inutile. Le soir, avant le couvre-feu il nous arrivait fréquemment
de circuler dans les rues de la ville pour arracher prestement quelques
pancartes disposées pour renseigner les occupants. Nous dissimulions ces
encombrants objets sous notre manteau. Cela nous procurait, en même temps
qu'une certaine satisfaction, un excellent combustible... De temps à autre nous
faisions également quelques campagnes d'inscription à la craie du « V » de la
victoire surmonté de la croix de Lorraine sur les murs de la ville. Ces petites
actions étaient préconisées par la radio de Londres. Cela faisait tellement
enrager les « Fridolins », qu'un certain jour à la suite d'une campagne
particulièrement active la ville fut « punie » par l'occupant qui imposa
pendant une semaine le couvre-feu à 20 heures. Ce qui nous comblait d'aise.
C'était là des actions bien mineures mais qui avaient cependant le mérite de
faire voir aux allemands que des français refusaient la collaboration
préconisée par Vichy.
Un jour d'occupation comme les autres au cours de
l'année 1943 (je ne puis en préciser la date exacte) deux allemands avec
chapeau mou et imperméable (tenue classique de la Gestapo) firent irruption
dans la salle à manger pendant le déjeuner. Sans explication, ils arrêtèrent
mon père et notre employé, mon ami Manuel. Nous apprendrons le lendemain qu'ils
sont tous les deux incarcérés à la prison de Chartres, rue des Lisses.
L'après-midi de ce jour le téléphone sonne et je suis prié par ces messieurs de
me présenter à 15 heures à la « maison allemande ». Ce délicat euphémisme
désignant le siège de la Gestapo. Je me rendis contraint et forcé à cette aimable
invitation. En ce lieu je serai interrogé pendant près d'une heure par le
commandant Rhôm, chef de cette police par l'intermédiaire d'une interprète
française (?), la femme Meyer, vendue à la cause Nazie. J'apprendrai par la
suite que les services secrets allemands recherchaient les ramifications d'un
réseau de résistance de Lucé dont le chef un certain Mattéï avait été pris et
fusillé. Une rue de Lucé porte désormais son nom. Nous étions étrangers à cette
affaire. Quelques jours plus tard mon père et Manuel furent relâchés sans avoir
subit de sévices. Nous avions craint le pire car la suite des événements nous
avait, hélas, prouvé que l'on sort rarement indemne des mains de ces gens là.
Les mois passaient mais bien lentement. Les rues de la
ville se couvraient souvent de sinistres affiches bordées de noir énumérant le
nom des français résistants ou otages fusillés par l'ennemi. Pendant ce temps
la radio de Vichy diffusait la voie chevrotante du vieux Maréchal et des
diatribes des membres de son gouvernement et autres collaborateurs notoires.
Les Etats-Unis qui, depuis l'attaque de Pearl Harbor,
étaient en guerre avec le Japon envoyaient vers les îles britanniques d'énormes
quantités d'hommes et de matériel en vue de l'ouverture d'un second front.
Brusquement les allemands envahissaient la zone sud. La flotte française,
accablante nouvelle, se sabordait dans la rade de Toulon plutôt que de
reprendre le combat aux côtés des Alliés. Ce tragique événement fut, pour nous,
durement ressenti surtout du fait que notre marine de guerre était à cette
époque à la fois puissante et moderne. Son ralliement aux Alliés aurait
représenté un appoint très important pour la suite de la guerre. La ligne de
démarcation n'existant plus, nous décidons alors de gagner le sud-ouest de la
France. Notre projet était de franchir clandestinement les Pyrénées, puis en
traversant l'Espagne, de parvenir en Afrique du Nord pour nous engager dans
l'armée de libération qui se constituait là-bas. Yves connaissait dans cette
région un ami de son père résidant à Albi. La situation géographique de cette
ville nous semblait favorable pour trouver une occasion de passage. Nous nous y
rendrons par le train et nous serons reçus et hébergés par ces gens si
sympathiques et si dévoués. Notre hôte, grâce à ses relations, nous fit
connaître une filière de passage, mais peu de temps avant le départ prévu
survint un événement qui anéantira nos projets. Un collaborateur notoire et
dangereux du nom de Lespinasse avait été exécuté par la résistance ce qui provoqua
de la part de l'occupant une surveillance accrue dans la région, rendant
impossible le passage des Pyrénées. A la suite de cette déconvenue nous
envisageons de rejoindre un maquis, mais les renseignements pris nous
indiquèrent que les groupes de la région avaient trop d'effectifs en hommes
pour un armement insuffisant.
Passablement déçus, nous renonçons à nos projets et,
via Moulins, regagnons Chartres. Voyage de retour sans histoire mais nous
devions cependant prendre quelques précautions car ne nous étant pas fait
recenser pour le travail obligatoire en Allemagne (S.T.O.) nous étions
considérés comme réfractaires pour l'occupant. Pour parer à toutes
éventualités, nous organisons une issue de secours pour évacuer l'immeuble de
la charcuterie en cas de danger. Il s'agissait d'un passage facile par les
toits et les murs voisins.
Enfin arriva le printemps 1944, la ville subissait des
bombardements incessants notamment sur le terrain d'aviation et sur les
installations ferroviaires. Ces actions étaient les préliminaires du
débarquement. Un avion allié qui venait bombarder le camp d'aviation fut touché
par la D.C.A. et lâcha ses bombes sur la place des Halles au milieu du
centre-ville. Une partie du quartier fut détruite. Une aile de l'hôtel de ville
qui abritait une bibliothèque de grande valeur devint la proie des flammes.
Quarante neuf personnes périrent à cause de ce déplorable accident. Ceci se
passait le 26 mai 1944. Le 6 juin vers 10 heures du matin, nous parvenons à
capter la B.B.C et avons la joie d'entendre la grande et émouvante voix du
Général de Gaulle annonçant que les troupes alliées venaient de lancer sur les
côtes de Normandie, une gigantesque opération de débarquement. Dans ce même
appel, il donnait l'ordre à la résistance d'entrer en action sur les arrières
de l'ennemi. Sur tout l'ouest de la France, les bombardements se multipliaient
: terrains d'aviation, routes, ponts, nœuds ferroviaires. La ville au bout
de quelques jours se trouva privée d'eau, de gaz et d'électricité. Le ravitaillement
était de plus en plus précaire et les journées entrecoupées de fréquentes
descentes aux abris. Après des semaines de durs combats, le front allemand de
Normandie se trouva déstabilisé. Ce fut la percée d'Avranches par laquelle
allaient s'engouffrer les blindés de Patton qui libéreront Le Mans et
s'avanceront en direction de Chartres. La vie y devenait de plus en plus
difficile. Les chambres froides ne fonctionnaient plus faute d'électricité.
Ceci nous obligeait pour conserver nos maigres marchandises à aller chercher
des pains de glace à la brasserie. Cet établissement avait été réquisitionné
par les allemands pour la fabrication de la bière. C'est à cette occasion que
nous fîmes la connaissance d'un prisonnier Nord-Africain que l'ennemi employait
à cet endroit.
En effet, depuis le début de l'occupation de nombreux
prisonniers français, notamment des Arabes étaient détenus dans une ancienne
caserne de l'armée française à Morancez, village situé à quelques kilomètres de
la ville. L'armée allemande en ce mois de juillet et d'août 44 était surtout
préoccupée d'assurer sa retraite devant la pression des armées alliées. La
surveillance de ces prisonniers s'étant fortement relâchée, ceux-ci circulaient
en ville à peu près librement quand le travail était terminé. Devant l'avance
des américains, les allemands avaient décidé de transférer le camp en Allemagne
d'où l'affolement bien compréhensible de ces pauvres gars. Le prisonnier avec
lequel nous nous étions liés d'amitié nous supplia de le faire évader. Après
l'accord facilement obtenu par mon père, nous prenons nos dispositions pour lui
trouver une « planque » en attendant la libération de la ville.
Il fut convenu que nous prendrions livraison du «
colis » un certain jour au début du mois d'août (je ne saurai en préciser la
date). Le jour prévu vers 17 heures, ce n'est pas un, mais CINQ types qui se
présentèrent à nous.
Malgré notre surprise nous acceptons de les prendre en
charge. Ils passeront la nuit à la charcuterie malgré la vive et légitime
inquiétude de ma mère. Vers 3 heures du matin, malgré le couvre-feu et après
les avoir tant bien que mal affublés de vêtements civils nous les conduisons à
leur retraite définitive. Il s'agissait d'une maison appartenant à la
grand-mère d'Yves située dans un quartier évacué à cause de la proximité de la
gare, donc une retraite relativement sûre.
Nos protégés resteront là, cloîtrés, une dizaine de
jours en attendant la libération de la ville. Nous devions les ravitailler tous
les jours en vivres et même en eau, ce qui n'était pas sans risque. Aussitôt
après l'arrivée des américains, ils purent reprendre leur liberté et nous
témoignèrent une vive reconnaissance. Cette opération assez hasardeuse avait
pleinement réussi.
Nous voici arrivés à la date du 15 août. Cette journée
nous apportera deux nouvelles capitales. Celle du débarquement dans le midi de
la France, plus précisément sur la côte varoise de la 1ére armée française
placée sous le commandement du Général de Lattre de Tassigny, et celle de
l'arrivée imminente de la colonne blindée américaine qui, sous les ordres du
Général Walton Walker devait libérer la ville. Leur aviation tactique, par des
patrouilles incessantes assurait la couverture aérienne des blindés.
Dans l'après-midi du 15, nous parvenons enfin à
contacter un responsable du groupe de résistance « Libération Nord »,
qui devait entrer en action dès l'arrivée des premiers chars. Nous sommes
convoqués le lendemain matin en tenue appropriée dans un immeuble abandonné par
les allemands, situé au coin de la place des Epars. Ceux-ci avaient laissé
quelques troupes de couverture qui, le 15 au soir occupaient les rues et les
carrefours. Troupes sacrifiées mais armées de redoutables grenades antichars,
les Panzerfaust. Le matin du 16 nous découvrons un char Sherman immobilisé et
partiellement détruit par un de ces redoutables engins, rue du Grand Faubourg.
L'équipage ayant, hélas, été tué. Vers 10 h, comme prévu, nous nous rendons à
la convocation du chef de groupe. Il régnait dans l'immeuble une grande
activité. De nombreux volontaires étaient présents. Chacun de nous se vit
pourvu, qui d'une mitrailleuse sten, qui d'un fusil d'infanterie anglais et de
munitions en nombre suffisant.
Peu de temps après, les chars américains, n'ayant
rencontré que peu de résistance débouchaient sur la place des Epars. Spectacle
inoubliable ! Immédiatement nos groupes F.F.I. sortirent de leur repaire pour
guider et éclairer les chars en attendant l'arrivée de l'infanterie américaine.
En fait cette formation ne devait parvenir dans nos murs que quelques jours
plus tard. Dans ces conditions le nettoyage de la ville incombait aux F.F.I.
dans la mesure de leurs moyens. A cet endroit de mon récit, je tiens à
reproduire intégralement le rapport officiel de l'inspecteur de police Aies qui
fut le chef de notre groupe de combat :
« Jean Aies, secrétaire de police du commissariat de
Chartres, chef de groupe F.F.I. rend compte de l'activité de ce groupe pendant
la période du 16 au 20 août 1944. 16 août à 16 h occupation du bâtiment des travailleurs,
place des Epars sous la direction du lieutenant Grimât.
Ce jour, constitution du groupe : Aies - Baudry -
Corbin - Gyteau - Berteau – Bobet - Baranez - Gérard - Jega - Seginger -
Polydor - Rauget - XX -
Activité du groupe : participation aux combats de la
porte Morard, pas de perte. L'après-midi, occupation de l'usine à gaz en
liaison avec un autre groupe. Attaque d'un canon (remonté à la préfecture) de
son camion de munitions, garé ensuite porte Morard par le capitaine des
pompiers. 6 prisonniers, 5 allemands tués. Puis attaque du cimetière. Perte : 2
tués : Rauget Jean et XX...
17 août. En liaison avec le capitaine Duroc occupation
du hangar de la caserne Marceau de la ligne de chemin de fer située à proximité
et des champs au delà de la ligne. Attaque des Trois-Ponts en liaison avec le
groupe occupant la ligne aux Trois-Ponts. Ce groupe, attaqué par l'artillerie
allemande et des armes automatiques se replie. Nous sommes à notre tour
attaqués par l'artillerie allemande et, après plusieurs demandes de renfort,
obligés de nous replier momentanément, vers 15 h 30. Trois blessés : Gyteau à
la tête, Corbin et Berteau aux jambes. Le groupe retourne aux Trois-Ponts à 17
heures.
18 août. Le groupe est scindé en deux parties, l'une
sous les ordres de Bobet Alexandre se rend aux Trois Ponts. L'autre sous mes
ordres, occupe la caserne Marceau jusqu 'à la prise en compte par les
américains. Patrouille sur la côte surplombant la rue des Perriers. Nous
essuyons plusieurs violentes rafales et nous dégageons sans perte.
19 août. Etant mis à la disposition du commissariat
aux renseignements généraux à la préfecture, je passe la direction du groupe à
Bobet. Le soir, je participe au nettoyage des bois de Barjouville.
20 août. Participation au nettoyage des bois de
Thivars.
Le chef de groupe Jean Aies »
En certains points de la ville, les allemands nous
opposèrent une vive résistance, notamment dans le secteur des Trois-Ponts. Le
quartier présentait au moment des combats un aspect lunaire car l'aviation
alliée avait été contrainte de bombarder le pont de chemin de fer à plusieurs
reprises avant de le neutraliser. Tout le terrain était creusé de cratères et
même le cours de l'Eure se trouvait détourné.
Une force allemande, comprenant paraît-il un millier
d'hommes, qui faisait retraite depuis la région d'Orléans, tenait fermement la
position. Ils possédaient en outre une ou deux pièces de canon anti-char. Les
F.F.I. dotées seulement d'un armement léger ne purent les réduire seules. Le 17
août au matin ils parvinrent même à progresser et à prendre un point d'appui
dans le périmètre des abattoirs, tirant plusieurs salves d'obus sur la ville.
Il fallut attendre l'arrivée de l'infanterie
américaine pour que cette importante poche de résistance fût réduite.
Il faut déplorer et condamner la sauvagerie des
troupes allemandes qui capturèrent un groupe de F.F.I. dans ce secteur et les
fusillèrent au mépris des lois de la guerre.
Quelques jours plus tard, au clos Pichot, les honneurs
militaires furent rendus à nos morts en présence d'André Le Troquer, Ministre
de l'Intérieur du gouvernement provisoire de la République.
Je ne voudrais pas terminer cette courte relation de
la libération de la ville telle que je l'ai vécue sans raconter, ici, une
anecdote. Le 16 août vers 11 heures du matin, je me trouvais avec mon groupe
devant la préfecture en compagnie d'éléments américains armés d'un canon
anti-char. A ce moment partent du grand clocher de la cathédrale quelques
rafales de balles à notre intention. Les artilleurs américains mirent alors
leur pièce en batterie en direction du clocher. Nous parvenons à grand peine à
les empêcher de tirer. On peut imaginer sans peine les dégâts irréparables qui
auraient été causés à notre belle cathédrale.
Le 16 août au matin eut lieu, avenue Maunoury, un bref
et violent engagement. Un groupe F.F.I. tenta d'intercepter un véhicule ennemi
fortement armé. Quatre combattants y laissèrent leur vie. Notre ami et camarade
de lycée Roger Joly fut grièvement blessé.
Nous eûmes à déplorer dans nos rangs la perte d'une
vingtaine de F.F.I. Plusieurs dizaines des nôtres furent blessés au cours de
ces opérations.
Ainsi que nous devions l'apprendre par la suite, si la
résistance fut peu active dans les villes du département, elle fut, par contre,
présente et efficace dans les villages et la campagne. Le terrain découvert de
notre région ne se prêtait évidemment pas à la constitution de groupes de
résistance importants. Il se forma cependant deux maquis. Celui de Plainville
et celui de Beaumont-les-Autels. Ce dernier commandé par le Baron Antoine de
Layre. Au moment de l'arrivée des américains, ces deux unités parvinrent à
s'emparer avec une certaine audace et aussi un grand risque de la ville de
Nogent-le-Rotrou. Les petits groupes constitués dans les villages menaient de
leurs côtés des actions limitées mais efficaces contre l'ennemi : attaque de
camions isolés, sabotages de voies ferrées, destruction de ponts etc... Le
viaduc de Cherizy, près de Dreux, qui était pour les allemands d'une grande
importance stratégique fut rendu inutilisable grâce à l'action de la
résistance. Les convois militaires destinés au front de Normandie se trouvèrent
bloqués à cet endroit. De nombreux parachutages d'armes eurent lieu dans la
campagne pour équiper les groupes de combattants F.F.I. et F.T.P. Nous devions,
par la suite retrouver ces courageux garçons parmi les effectifs du 1er
bataillon d'Eure-et-Loir.
2ième partie
21 août 1944 - 23 mai 1945
Journal de route
Le 21 août, la libération de la ville était chose
faite. Une alternative se présentait à nous. Ou nous devions, selon le jargon
militaire, rentrer dans nos foyers et rendre nos armes où nous prenions la
décision de poursuivre le combat. Nous choisissons la deuxième solution.
Le 22 de ce mois, le lieutenant de Layre avait
installé un petit bureau dans les locaux de l'hôtel du conseil général situé
derrière l'actuel monument Jean Moulin. Il recherchait des volontaires pour la
formation de corps francs devant participer à la libération de Paris. Nous
n'hésitons pas à nous enrôler non sans avoir prévenu nos parents de notre
initiative, assez bien acceptée, malgré quelques craintes, il faut le dire.
Trois groupes F.F.I. de chacun une dizaine d'hommes furent constitués sous le
commandement du lieutenant de Layre. Nous serons tous deux affectés au groupe
Ménard. C'était un homme d'une trentaine d'années, compétent, sympathique et
même paternel qui nous commandait.

Le lendemain, nous prenons place dans des camions pris
à l'ennemi et partons en direction de Paris. En cours de route, ordres et
contre-ordres se succédèrent (c'est déjà l'armée). Deux groupes seront dirigés
vers Paris, notre groupe commandé par de Layre et Ménard se dirigera vers
Fontainebleau. Après un voyage sans histoire, nous arrivons sur les bords de la
Seine, dans le charmant village de By-Thomery. Les habitants nous réservèrent
un chaleureux accueil avec cognac et cigares.
Le soir même, nous prenons position à Samois sur les
bords du fleuve. Le lendemain matin notre groupe prendra place dans des barques
pour occuper une île sur le fleuve, où paraît-il, se trouvaient encore des
allemands. Mais nous rentrons bredouilles. Les jours suivants, plusieurs patrouilles
sont organisées dans la campagne. Au cours de l'une d'elles, nous recevrons
sans combat la reddition d'une trentaine d'allemand qui seront désarmés et
conduits en lieu sûr. Nous devions aussi, dans ce secteur, participer avec les
américains à une longue patrouille de nuit de 30 kilomètres vers le village de
Machaux, marche épuisante et inutile car nous ne rencontrerons aucun gibier.
Les jours suivants, nous serons affectés avec des
soldats américains à la gare du pont de Champagne sur Seine. L'ancien pont
ayant été détruit par l'ennemi en retraite, avait été provisoirement
reconstruit solidement par les sapeurs du génie américain. On appelait cet
ouvrage un pont « Belley ». Cette tâche était assez agréable car nous pouvions
fraterniser avec les soldats US. qui nous gavaient de friandises comme des
enfants.
Après une semaine passée dans cette jolie région,
notre groupe, transporté dans un vieil autocar brinquebalant, se retrouva dans
le village de St Père près de Meung sur Loire. Nous prendrons nos cantonnements
dans l'école. Je me propose comme cuistot du groupe et élabore une cuisine
rudimentaire dans une marmite à cochons... Puis notre groupe après quelques
jours de vie champêtre vit arriver l'inévitable autocar qui nous transportera à
Cosne sur Loire. Voyage mutile car là non plus nous ne rencontrerons aucun
allemand. La fin de ce périple se fera à Garnay près de Dreux.
A proximité de cette bourgade, les Américains avaient
installé une importante base aérienne que nous allions visiter pendant nos
heures de repos. Les appareils qui équipaient ce terrain étaient des
bombardiers moyens, type « Marauder ». Ils portaient un équipage de deux hommes
et allaient quotidiennement en mission de guerre au dessus de l'Allemagne. Lors
de ces visites, nous eûmes le plaisir de nouer des relations amicales avec un
mécanicien au sol d'origine québécoise, ce qui nous permettait d'avoir avec lui
des conversations en français.
Après quelques jours de cantonnement dans ce village,
une permission de cinq jours nous sera accordée ce qui nous permettra d'aller
voir nos parents à Chartres et même à Moulins.
Nous voici au mois de septembre, tous les groupes
F.F.I. et F.T.P. de la région sont rassemblés à Dreux à la caserne de Billy. Le
29 de ce mois, après un conseil de révision assez sommaire, nous signons notre
acte d'engagement volontaire pour la durée de la guerre. La plupart de nos
compagnons accompliront la même démarche. Ainsi sera constituée une unité
régulière de l'armée française qui portera le nom de « 1er bataillon
de marche d'Eure-et-Loir ».
Commence alors la vie de caserne avec ses contraintes,
ses corvées, sa monotonie mais aussi les exercices et manœuvres
indispensables à la formation d'un fantassin. Notre effectif était, à ce moment
d'environ 700 hommes, officiers et sous-officiers compris. Peu de temps après
notre arrivée à la caserne, quelques camarades furent désignés pour se rendre à
Cherbourg et prendre livraison de matériels et d'équipements nécessaires au
bataillon. Il s'agissait, en fait de fournitures et d'armements de l'armée
britannique. Le matériel routier se composait d'une dizaine de camions «
Bedford » d'une charge utile de 2 tonnes 5, d'autant de camionnettes de même
marque, bâchées, également de plusieurs motocyclettes et side-cars. Chaque compagnie
se vit dotée d'une chenillette blindée de ravitaillement d'infanterie.
L'armement de la troupe était le fusil d'infanterie anglaise modèle 1914.
C'était un lourd engin qui tirait seulement au coup par coup et possédait une
boîte de chargeur de cinq cartouches.
Il faut dire, qu'à cette époque, le fusil d'infanterie
allemand le Mauser n'était pas plus performant. Cependant, à ces armes peu
rapides furent adjointes des fusils-mitrailleurs, anglais, eux aussi, de marque
Bren, capables de tirer 500 balles par minute et stockés dans des boîtes
chargeur. J'ajouterai que cet armement fut complété par la suite par
l'attribution à chaque compagnie de mortiers légers de 60. La compagnie
d'engins (la 5ème) fut pourvue de lourds mortiers de 81. Les uniformes étaient
ceux de l'armée britannique très pratiques et assez seyants : casques plats à
larges bords, capotes, blousons, pantalons kaki, courtes guêtres de cuir jaune,
baudrier et cartouchières de même.
L'organigramme de notre unité se composait comme suit :
Une compagnie de commandement qui comportait plusieurs
sections, notamment une section de transmission, une section de pionniers, une
section sanitaire. A cela, il fallait ajouter plusieurs services, le train-auto
et la mécanique, l'armurerie et aussi les services administratifs nécessaires
au fonctionnement du bataillon.
Le corps de troupe proprement dit se composait de 5
compagnies d'une centaine d'hommes. Chaque section étant divisée en 3 groupes
de combat qui constituaient donc l'unité de base. Le groupe de combat
comportait une dizaine d'hommes de troupe commandée par un sergent et un
caporal.
Chaque groupe en plus de l'armement individuel était
doté d'un fusil mitrailleur. Cet organigramme était, je pense, celui de
l'infanterie de cette époque.
La solde qui était payée aux hommes de troupe était de
810 francs par mois, ce qui, à ce moment représentait une somme assez
appréciable.
J'ouvrirai ici une parenthèse pour présenter un de nos
sous-officiers.
Parmi les militaires de cette catégorie se trouvait un
certain adjudant Germain dont je vais, brièvement, faire le portait. Cet homme
était ce qu'on peut appeler une figure, je dirai même « une gueule ». Un type
mince, sec, solide, au visage maigre et aux cheveux grisonnants. Il s'était
engagé très jeune dans les corps francs de l'infanterie pendant la guerre
14-18, ce qui n'était pas rien. Il eut, sur le front français une conduite
héroïque ce qui lui valut de terminer la guerre avec la médaille militaire et
la légion d'honneur. Il était ce que l'on appelle aujourd'hui un vrai
baroudeur, grand amateur aussi de la chopine...
Pendant la dernière guerre, il participa à la
résistance puis, n'hésita pas, malgré son âge, à rejoindre nos rangs. Etant
donné son grade, il s'efforçait quelques fois maladroitement de faire respecter
la discipline ce qui lui valait quelques inimitiés parmi les soldats. Cependant
au fond, chacun l'aimait bien et le respectait.
Ainsi armés et équipés, nous poursuivons notre
entraînement à Dreux jusqu'à la fin du mois de novembre.
Un événement vint rompre la monotonie de la vie de
caserne. On nous apprit que notre unité aurait l'honneur de participer à un
important défilé militaire aux Champs Elysés, en présence du général de Gaulle
et de Winston Churchill à l'occasion du 11 novembre. Les troupes furent
acclamées par une foule nombreuse, mais tous deux n'en eûmes que le récit car
nous étions, ce jour là, de garde à la caserne. Ce qui nous causa, il faut le
dire, une certaine déception.
Peu de temps après la réception du matériel, je fus
affecté en tant que chauffeur de camion à l'armurerie. Ce service était dirigé
par un sergent auquel était adjoint un caporal-chef. Je pris mes quartiers dans
cet endroit assez paisible où de nombreuses corvées m'étaient épargnées. Notre
vie militaire suivait son train-train quand nous parvint la nouvelle de
l'affectation du bataillon au 131ème régiment d'infanterie. L'ancien
131ème ayant été dissout en 1940. Il fut décidé de le reconstituer
avec des éléments des anciens F.F.I. A cette époque les régiments d'infanterie
se posaient en trois bataillons. Le 1er et le 2ème
bataillon du nouveau 131ème seraient composés d'anciens F.F.I. de
l'Aube, le 3ème bataillon serait celui d'Eure-et-Loir. Cette
dernière disposition était rendue nécessaire pour une affectation sur un front
de guerre. Chacun de nous se réjouissait de pouvoir participer tant soit peu
aux combats libérateurs.
 Le
11 novembre 1944. Le Bataillon défile aux Champs Elysées.
Le
11 novembre 1944. Le Bataillon défile aux Champs Elysées.
Pour des raisons évidentes, le nouveau régiment devait
porter le même uniforme, c'est la raison pour laquelle, à notre grand regret,
on nous changea nos confortables tenues anglaises contre des uniformes français
de mauvaise qualité. On nous équipa même de casques italiens fort disgracieux.
Au début de décembre, le bataillon reçut l'ordre de
faire mouvement vers la ville de Bourges. Les compagnies à pied gagnèrent cette
ville par le train dans les classiques wagons à bestiaux, modèle 1914 (hommes
40 - chevaux en long 8). Le convoi ainsi formé atteignit Bourges après un long
détour par le Massif Central car tous les ponts franchissant la Loire avaient
sauté par fait de guerre. Le train de matériel dont je faisais partie fut
chargé sur des wagons plate-forme et via Chartres, gagna Orléans où il fut
débarqué. On nous réunit alors en convoi pour atteindre Bourges par la route.
Notre unité au grand complet pris ses nouveaux quartiers à la caserne Carnot.
C'était un ensemble de bâtiments en longueur, sans étage, vétustés, assez
éloignés du centre ville.
A cette époque, Bourges était une importante ville de
garnison. Dans le courant du mois de décembre survinrent des événements assez
peu connus. En plus des unités régulières de l'armée, il y avait en
cantonnement dans cette ville, un régiment constitué d'anciens francs-tireurs
et partisans (F.T.P.) d'obédience communiste qui s'intitulait 1er
régiment populaire du Berry (1er R.P.B.). Cette unité prétendait ne
pas obéir à l'Etat Major de l'armée. C'était donc un régiment factieux. Cet
état de choses regrettable existait également dans d'autres départements du
centre et du sud de la France. Le général de Gaulle décida alors de dissoudre
ces unités illégales. A Bourges, cela n’alla pas sans quelques
difficultés. Pour cette raison, notre bataillon fut mis en état d'alerte
maximum, gardes renforcées, patrouilles armées en ville etc ...
Enfin après quelques jours de tension tout rentra dans
l'ordre sans heurt et sans accrochage. Un certain nombre de ces agités vint
grossir les rangs de notre unité qui comptait à ce moment là un effectif
d'environ 800 hommes. Au cours de notre séjour à Bourges, j'eus l'occasion à
plusieurs reprises d'aller en mission avec mon camion à Chalons sur Marne pour
y chercher des équipements auprès de l'intendance de cette ville. L'hiver 44-45
fut froid et neigeux. Je dus me rendre à cet endroit vers la fin de décembre en
camionnette découverte accompagné par le sergent-chef Dubois. Le parcours aller
et retour fut glacial par des routes neigeuses et glissantes. Je pense avoir,
ces jours là, contracté la pleurésie qui m'a tant gêné et fatigué par la suite.
A cette période, la région Est était, au point de vue militaire, en pleine
effervescence car l'armée allemande venait de lancer une vigoureuse
contre-offensive dans les Ardennes sous le commandement du général Von Rundstet.
Cette opération faillit réussir, l'aviation américaine
était bloquée au sol par le mauvais temps et ne pouvait pas entrer en action
pour détruire les blindés ennemis. La situation se rétablit au dernier moment,
notamment grâce à l'héroïque résistance des troupes américaines à Bastogne.
Depuis notre affectation au 131ème régiment d'infanterie, si nous
avions changé nos uniformes, nous avions dû, par contre, conserver notre
armement anglais.
Au début de février arriva enfin, un ordre de
l'Etat-major : notre unité devait se rendre à Luçon en Vendée pour y rejoindre
le 1er et le 2ème bataillon. L'ensemble du régiment
devait prendre position sur le front de la Rochelle. Un long convoi ferroviaire
fut alors formé et le bataillon avec tout son matériel se dirigea vers cette
destination. Le déplacement de notre unité avec armes et bagages représentait
un spectacle assez impressionnant qui nous causait une certaine fierté, il faut
l'avouer. Après une journée de voyage au cours duquel nous traverserons les
marais vendéens, notre convoi arriva à destination. Les quartiers furent pris à
la caserne Hoche. Nous y passerons environ une semaine puis un certain dimanche
notre nouveau 131ème régiment aura l'honneur de défiler, musique en
tête dans les rues de la ville où nous serons salués par la population aux cris
de « vive l'armée française ».
Quelques jours après ces fastes militaires, des
dispositions furent prises en vue de notre départ pour le front.
Les compagnies sont remaniées. Yves se trouve affecté
à la lère, 2ème section, aspirant Hurel. Ayant
naturellement le désir de rester avec lui, je demandais et obtins ma mutation
dans cette compagnie et je pus ainsi rester à ses côtés. Un matin, vers 6
heures, le départ est donné. Un convoi de camions nous transportera jusqu'au
lieu dit les Alouettes. Puis, départ à pied pour un parcours d'environ 10
kilomètres. La troupe traversa la ville de Marans dont les habitants avaient
été évacués. Enfin, nous arrivons sur la ligne de front pour assurer la relève
de groupes de F.F.I. Vendéens.
 Février
1945. Notre groupe de combat sur le front de la Rochelle (MARANS).
Février
1945. Notre groupe de combat sur le front de la Rochelle (MARANS).
La ligne, dans ce secteur, prenait appui sur la voie
ferrée. Nous apparaît alors la faiblesse de notre ligne de défense. Elle était
uniquement constituée de postes d'infanterie établis tous les 100 mètres
environ. Il n'existait pas de deuxième ligne et pratiquement pas d'artillerie
ce qui était assez incroyable. Dans ces conditions, il était bien évident que
nous ne pourrions résister longtemps à une attaque même de faible envergure.
Notre groupe de combat était commandé par le sergent
Legrand, un petit gars bien sympathique, assisté de deux caporaux Pailleau et
Tilmand. Dès notre arrivée en ligne, nous nous employons à fortifier la
position qui en avait bien besoin : pose de barbelés, position enterrée pour le
fusil-mitrailleur, trous individuels. Ces modestes aménagements étant établis
le long de la voie ferrée. Notre poste se trouvait à proximité d'un petit
bâtiment, annexe de la gare. Celle-ci à notre gauche abritait le groupe
Barrière. A notre droite se trouvait le groupe Potron. Comme chacun peut le
comprendre la ligne de front avec des postes isolés et vulnérables ressemblait
à une passoire...
Les positions allemandes qui nous faisaient face
étaient établies à environ 7 à 800 mètres en bordure d'une route nationale plantée
d'arbres.
Le no man’s land était une plaine légèrement
creusée en cuvette. Dans la journée le front était calme. La nuit était assez
souvent ponctuée de rafales d'armes automatiques.
Malgré le calme du front, les conditions physiques
étaient assez dures car nous n'avions que peu de temps pour dormir. Ceci à
cause des patrouilles nocturnes nécessaires pour assurer la liaison entre les
deux groupes voisins. De plus, le ravitaillement était assez mauvais, notre
compagnie restera dix jours en ligne. Je dois cependant ajouter que nous eûmes
à faire face sur notre position à trois incidents que j'évoquerai dans l'ordre
chronologique. Un certain soir, nous apprenons que l'ennemi possédant un train
blindé risquait de venir nous attaquer dans la nuit. Pour tenter de faire
obstacle à ce danger des poteaux télégraphiques bordant la voie furent, sur
ordre, sciés et jetés sur le ballast. Notre poste resta en alerte toute la
nuit. Notre armement léger avait été complété par un bazooka, arme anti-char.
Le petit matin arriva sans que nous ayons vu ce train fantôme, Dieu merci.
Le 28 février (une date que je n'oublierai pas), le
soir, nous constatons une agitation anormale dans les lignes allemandes et de
nombreux bruits de véhicules roulant sur la route.
Le lendemain matin vers 8 heures, pendant la «
dégustation » du café, l'alerte est donnée par nos sentinelles. L'artillerie
allemande se réveille et nous canonne à l'aide de fusants (obus à mitraille,
très destructeurs pour le personnel en terrain découvert). Nous gagnons à la
hâte nos trous individuels. Quelques minutes plus tard un obus vient percuter
le sol à moins de 4 mètres devant moi. Violente lueur, suivie d'une forte odeur
de poudre puis, l'instant après d'une forte détonation. Des pierres viennent
frapper mon casque. Je sortirai indemne de ce mauvais pas bien qu'assez
effrayé, je dois l'avouer. Le projectile qui avait failli me tuer avait
sectionné le rail sur une longueur de un mètre. Cette salve d'artillerie était,
en fait, un tir de diversion car l'ennemi venait de lancer une vigoureuse
attaque à notre gauche dans le secteur tenu par le 1er bataillon
dont la position fut enfoncée. L'adversaire faisait de temps en temps des
incursions dans l'arrière pays pour se procurer du ravitaillement. Il y eut ce
jour là plusieurs tués et blessés au 1er bataillon. Dans
l'après-midi, le 8ème Zouave, régiment d'élite de la 2ème
division blindée lançait une contre-attaque décisive qui rétablit le front.
Quelques jours plus tard, nouvelle alerte, toute la nuit nous entendons des
bruits suspects près de nos lignes. Au petit matin, grand remue-ménage à notre
droite, une patrouille allemande venait pour se rendre avec tout son armement.
Les gars du groupe Potron mettront rapidement tout ce beau monde en lieu sûr.
Après ces dix jours passés en ligne, nous serons
relevés par des soldats du 95ème régiment d'infanterie (je crois).
Nous apprendrons par la suite que ce poste avait été attaqué de nuit et décimé
quelques jours après notre départ.
La relève effectuée, nous serons transportés en camion
jusqu'à Chaillé-les-Marais après avoir traversé la Sevré Niortaise sur un pont
de bateaux. Dans cette localité était installé le P.C. du régiment. Notre
groupe se vit attribuer un cantonnement dans le garage du notaire. Le
lendemain, nous verrons notre sort s'améliorer grâce à notre installation
définitive dans un grenier garni de paille. Nos maigres repas sont pris dans
une rue du village, assis sur le trottoir. Il faut dire, pour excuser la
mauvaise qualité de la nourriture, que nos cuistots faisaient ce qu'ils
pouvaient avec ce qu'ils avaient, les repas étant préparés dans de vieilles
cuisines roulantes allemandes. En cet endroit notre repos était assez relatif
car il nous fallait monter de multiples factions. Les tours de garde se succédaient
à cadence rapide. Quelques jours plus tard, Yves vit arriver avec satisfaction
son ordre de départ pour une permission de détente de dix jours. Pendant son
absence, je serai affecté à la garde du P.C. du régiment et j'aurai alors
l'honneur de présenter les armes au général de Larminat, commandant en chef du
théâtre d'opérations du front de l'Atlantique.
Mon état de santé était à ce moment assez mauvais,
essoufflements, maux de tête, fièvre, fatigue générale. Pour cette raison, je
me vis contraint de me faire hospitaliser. Je me rendis à Aine, petit village
voisin où était installée une infirmerie de campagne. C'était un lieu malpropre
installé dans une grange vétuste. Je passerai là trois jours, couché comme mes
camarades d'infortune sur un cadre de bois recouvert d'une mince couche de
paille. Les soins étaient tout à fait insuffisants. La nuit, les souris
venaient manger dans nos gamelles les reliefs du repas. Bien qu'assez mal en
point, je réussis à quitter ce triste lieu, les reins brisés et tant bien que
mal je repris mon service. Peu de temps après mon retour, nous apprenons que
les permissions étaient suspendues car notre bataillon devait changer de
secteur. J'eus la mauvaise surprise d'apprendre que j'étais sur la liste de
départ.
Enfin, un beau matin arriva un convoi de camions GMC
conduit par des Nord-Africains de la 1ère Armée. Chacun prit place à
bord et vers 15 heures, le départ fut donné vers Niort puis Saintes, notre point
de chute étant la petite ville de Pisany. Les cantonnements seront établis au
milieu d'une population assez peu sympathique, peu soucieuse semble-t-il de
voir déranger ses petites habitudes. Le lendemain de notre arrivée, plusieurs
compagnies seront mises à la disposition du capitaine Lenfant. Sous les ordres
de cet officier, nous devions décharger des trains de munitions d'artillerie
qui arrivaient à la cadence de deux trains par jour. C'était un travail
fatiguant que nous accomplissions cependant avec bonne humeur. Il s'agissait
principalement d'obus de 75 et de 155. Cet impressionnant arsenal fut déposé
par nos soins dans une carrière proche du village.
Chacun se réjouissait de penser que toute cette «
ferraille » allait prochainement être judicieusement distribuée sur la g... de
l'ennemi. Les bruits d'une attaque décisive sur Royan semblaient se confirmer.
Le 1er avril, jour de Pâques, Yves rentrait de permission. Quelques
jours plus tard, nouveau départ dans cette direction. Le bataillon quittera en
bon ordre et en chantant cette bourgade si peu accueillante. Après une marche
d'une dizaine de kilomètres sous un soleil déjà chaud, notre compagnie arriva
au hameau Le Chais situé près des avant-postes.
En chemin, nous apercevons dans une prairie une batterie
d'artillerie en action qui procédait à des tirs de harcèlement. Les pièces
d'assez fort calibre étaient, je crois, des 155 courts. Les servants, torse nu,
chargeaient leurs canons, avec ardeur et chacun de saluer en passant ces braves
artilleurs. Le P.C. du bataillon était installé dans le hameau à quelques
centaines de mètres de la ligne de front. Aussitôt arrivés, nous procédons à la
relève des avant-postes. Notre ligne de défense était, cette fois établie d'une
façon plus rationnelle que devant Marans. Il s'agissait pour nous d'occuper des
tranchées profondes seulement d'un mètre vingt mais qui offraient cependant une
protection assez efficace contre d'éventuels tirs de l'artillerie adverse. Ces
modestes aménagements étaient creusés en zigzag et comportaient en plus des
positions F.M. des excavations de même profondeur recouvertes de madriers et de
terre dans lesquelles pouvaient prendre place deux hommes pour les heures de
repos. Aussitôt arrivé chacun s'empressa d'aménager son « gourbi » de la façon
la plus confortable. Nous passerons là une dizaine de jours assez tranquilles,
si ce n'était, évidemment les gardes de jour et de nuit. Devant nos
avant-postes s'étendait une vaste prairie plantée d'un joli cerisier en fleurs.
Dans le no man's land qui séparait les lignes
adverses, s'étendaient de vastes champs de mine anti-char (les Teller mines).
Plusieurs sections de notre bataillon furent désignées pour aller, chaque nuit,
détecter et neutraliser ces dangereux engins, ce qui n'était pas sans risques.
Les positions de l'adversaire étaient installées au
delà d'un vallonnement : la côte de Médis. La totalité du régiment occupait la
ligne de front.
Vers 20 heures, le 14 avril, je reçus l'ordre de me
rendre au P.C. du bataillon pour y chercher le courrier. Je trouvais là une
certaine effervescence et une lettre de mes parents m'apprenant la mort de
Roosevelt. Dans cette missive, ils me faisaient part de leurs craintes car il
circulait à l'arrière des bruits persistants d'une offensive dans le secteur de
Royan. Avant mon retour sur la ligne de front, j'eus la stupeur d'apercevoir à
l'orée du village une longue file de chars Scherman marqués de l'insigne de la
2ème D.B. J'en conclu évidemment que l'attaque était imminente. Vers
20 heures, j'étais de retour aux avant-postes. Après le repas du soir, nos
commandants de compagnie reçurent l'ordre de prendre certaines dispositions en
vue de l'attaque.
La 5ème
compagnie (cie engins) devait se porter « en douceur », vu la proximité
de l'ennemi près de la côte de Médis. Des sections de soutien viendraient les
appuyer. Nous sommes désignés tous deux pour venir compléter la section
Marchand. Des munitions nous sont distribuées ainsi que des pelles-bêches. Vers
minuit, le départ est donné par une nuit heureusement assez obscure. La
progression de cette avant-garde se faisait sans problème et... presque sans
bruit sans trop de danger non plus car les sapeurs démineurs avaient nettoyé
les nuits précédentes un terrain infesté de mines.
Vers 2 heures du matin, nous parvenons sans difficulté
sur l'objectif sur un terrain un peu accidenté. Nous étions Yves et moi à ce
moment, séparés. Je me trouvais à l'orée d'un petit bois avec le caporal
Pailleau. Aussitôt arrivés sur la position, l'ordre nous est donné de creuser
des trous individuels. Après cet épuisant travail, nous prendrons quelques
heures de repos bien mérité.
A 5 h 45 environ, d'un seul coup, à notre grande surprise,
éclatait le tonnerre. Les premières minutes nous sommes abasourdis et planqués
dans nos trous, puis vient une accoutumance à ce vacarme. Il s'agissait de la
préparation d'artillerie précédant l'attaque. Nous pouvions distinguer
nettement les départs secs et rapides des canons de 75, puis les coups plus
espacés et plus puissants des pièces de plus fort calibre. Les obus passaient
au dessus de nous avec un ronflement sinistre et allaient s'écraser sur les
positions allemandes. A 6 h 35 exactement, (document historique) le tir de
barrage s'arrêta net. A notre droite chacun pu voir dans une vaste plaine
l'arrivée des blindés de la 2ème D.B., spectacle magnifique !
Les chars avançaient en ligne dans la brume du matin
s'arrêtant pour tirer au canon, puis repartaient en avant, balayant le terrain
de leurs mitrailleuses. Le 8ème Zouave, régiment d'élite de la 2ème
D.B. suivait les engins pour nettoyer et occuper le terrain.
Dans ce secteur l'ennemi utilisait pour bombarder nos
positions, des batteries de fusées de type « V.K. », armement
révolutionnaire pour l'époque. Lors de l'attaque, ces engins tombèrent entre
nos mains, et furent retournés contre l'adversaire, servies par des éléments de
la 5ème compagnie.
Dès le début de l'attaque, nos forces navales
entrèrent en action. Etaient engagés, le cuirassé Lorraine, le Basquet et
l'Alcyon, les escorteurs Aventure, Découverte, Surprise et Hova.
Le capitaine de vaisseau Congé (chef d'E.M. de
l'amiral Ruel) était chargé d'étudier les plans d'attaque en liaison avec le
D.A.A.
Les objectifs, Royan et Pointe de Grave seraient
bombardés par le Lorraine et le Duquesne (canons de 340 et de 203). L'aviation
de la R.A.F, apporterait son soutien.
Les défenses allemandes reçurent 3.500 coups de moyens
et gros calibres écrasant les défenses adverses sous un déluge de feu.
L'aviation tactique française entrait également en
action pour appuyer la progression des chars. Nos appareils traçaient de longs
sillages dans le ciel bleu de ce début d'avril. Au dessus de nos têtes, un
avion d'attaque fut touché par la D.C.A. allemande. L'appareil tomba en flammes
non loin de nous. A notre soulagement, les deux hommes d'équipage parviendront
à sauter en parachute et tomberont dans nos lignes. Après ce début de matinée
plutôt agité, nous nous restaurons de sardines et de vin, puis vers 14 heures,
les compagnies reçurent l'ordre de regagner la position de départ. Malgré le
déclenchement de l'offensive, nous n'aurons pas eu, ce jour là, l'occasion de
tirer un seul coup de fusil. Je puis, ici en donner l'explication. Notre
compagnie avait été placée en position de soutien dans le but de contenir une
contre-attaque de l'ennemi mais la puissance de notre offensive était telle que
les positions allemandes furent, dès le début de l'attaque, complètement
débordées.
De plus, nos adversaires manquaient, paraît-il de
munitions et de carburant. Pendant cette matinée, les mortiers de la 5ème
compagnie s'employèrent activement à tirer sur les avant-postes allemands.
En arrivant à nos tranchées, nous apprenons avec
satisfaction que l'attaque était très réussie, les objectifs fixés pour ce
premier jour ayant été largement dépassés.
Nous passerons une nuit paisible et reposante dans nos
gourbis, cette fois sans être dérangés par les gardes de nuit, situation qui
fut par tous grandement appréciée. Le lendemain matin 16 avril, le bataillon se
remit en marche pour occuper le terrain conquis. Nous avions, à ce moment,
abandonné le lourd sac à dos que les poilus de 1914 appelaient « l'as de
carreau ». Il sera remplacé par « le sac sénégalais ». Il s'agissait, en fait,
d'une toile de tente roulée en diagonale dans laquelle se trouvait une
couverture pour la nuit, le tout porté sur le dos. A cet équipement plus léger
venait s'ajouter le lourd fusil anglais, les cartouchières, la pelle-bêche, au
côté la baïonnette et bien sur le précieux bidon en tôle émaillé. Tout cela
représentait une lourde charge. Il faut dire que pendant ces trois mois de
campagne, si nous n'eûmes pas à souffrir de la pluie, nous avons eu à supporter
les caprices d'un soleil assez ardent pour la saison.
Donc le 16 avril, notre unité se mit en marche en
direction de Royan. S'ouvrait devant nous, une vaste plaine légèrement
vallonnée parsemée de bouquets d'arbres. Le spectacle qui s'offrait à nous
était assez grandiose. C'était celui d'une armée en marche. Le terrain était
parcouru en tous sens par des troupes à pied et sillonné par de nombreux
véhicules : chars, chenillettes, camions de ravitaillement, pièces
d'artillerie. Nous passons près d'un char français gravement endommagé par une
mine. Une chenillette de chez nous subit ce mauvais sort, son conducteur, notre
camarade Loyer fut grièvement blessé. La troupe en colonne par un, passa auprès
d'un champ hérissé de longs pieux plantés par l'ennemi pour empêcher
l'atterrissage des planeurs. Cadavres allemands et équipements épars, un
allemand mort, la tête recouverte, dérision macabre, un parapluie gisait sur le
bord de la route. Leurs cadavres étaient paraît-il piégés, interdiction de les
toucher, ce qui démontre bien la traîtrise de l'ennemi.
Ce même soir, notre bivouac fut installé dans une
prairie plutôt fraîche et humide au petit matin. Dans la journée, on nous
distribua pour la première fois des rations américaines. Chaque homme recevait
6 boîtes par jour : viande, légumes, biscuit, chocolat vitaminé, le tout assez
varié. Nous attendrons toute la journée l'arrivée d'hypothétiques camions.
L'après-midi de nombreux chars Scherman passaient sur la route.
Chacun de nous était impressionné par ces glorieux
combattants et leur beau matériel. J'ouvrirai, ici, une parenthèse pour donner
quelques explications sommaires sur ces engins.
Ces matériels d'un poids de 35 tonnes construits en grande
série par les américains étaient armés, outre d'une mitrailleuse lourde, d'un
canon de 75mm sur tourelle mobile. Leur vitesse n'était pas très élevée et leur
blindage insuffisant. Ils étaient, paraît-il, nettement surclassés par les
chars allemands Tigre et Panther. Ils prirent cependant une part active et
décisive à la bataille de France après le débarquement du 6 juin.
Pour en revenir à nos moutons qui étaient des moutons
à pied... Voici qu'arrivèrent enfin dans la soirée les camions tant attendus.
Notre voyage s'effectuera de nuit sur une route parsemée d'entonnoirs. L'air de
la mer, toute proche se faisait sentir. Au cours d'une halte chacun put
apercevoir des masses noires dans les fossés, c'était des cadavres allemands.
Le convoi traversa Royan, qui venait de tomber entre nos mains. Dans la
pénombre, nous apparut une ville dévastée, il y flottait une odeur de cadavre.
Triste spectacle. Puis ce fut l'arrivée à Etaules à 2 heures du matin. Le reste
de la nuit se passa dans une prairie, glaciale. A notre réveil, près de nous
passaient des Half-tracks de la 2ème D.B. qui partaient en patrouille. Un type
de la compagnie captura un jeune allemand armé d'une grenade. Notre prisonnier
était absolument terrorisé car il croyait que nous allions l'exécuter. Bien
entendu, il n'en sera rien.
Les habitants d'Etaules nous accueillirent
chaleureusement et nous distribuèrent du lait chaud, réconfort très apprécié.
En fin de matinée, plusieurs compagnies dont la nôtre, accompagnées par des
chenillettes partirent en patrouille dans une plaine marécageuse.
En cet endroit, nous pataugerons désagréablement et
rentrerons épuisés sans avoir rencontré l'adversaire. Toutes ces journées
m'avaient bien fatigué car mon état de santé n'était pas très brillant, ce qui
m'affectait un peu le moral.
Puis ce fut le départ pour Saujon en camion. En
arrivant à la gare une distribution de vivres nous fut faite avant
l'embarquement pour une destination inconnue. Le bataillon avec tout son
matériel prit place dans un long convoi, les hommes de troupe étaient installés
dans des wagons garnis de paille. Le départ sera donné à 19 heures, ce 17 avril.
Chacun était assez satisfait de ce déplacement car
nous allions enfin, pouvoir dormir et récupérer dans des conditions de confort
relatif.
Après un voyage d'une sage lenteur, nous traversons la
gare de Bordeaux et nous apprenons alors que notre destination sera la Pointe
de Grave. Nous parviendrons à la gare de Lesparre le lendemain 18 avril vers 15
heures. Aux abords de la gare se dressait une grande tente hôpital ce qui donna
à chacun l'occasion de réfléchir sur la situation... Aussitôt débarqué, notre
unité pris place dans un long convoi de camions qui nous conduisit jusqu'au
terrain d'aviation de Grayan. Le bivouac sera établi dans une plaine
sablonneuse située à proximité. Le soir tombant chacun s'organise : repas froid
avec les conserves américaines car il était, bien entendu interdit d'allumer
des feux à cause de la proximité des positions allemandes. Le vent, venant de
la mer était assez vif, nous creusons quelque peu le sable pour nous en
abriter. Puis, le camp s'endormit paisiblement. Vers minuit, des ordres fusent
« chefs de section, rassemblez vos hommes, départ dans un quart d'heure ».
Il y eut bien quelques grognements réprobateurs,
assortis même de quelques jurons mais comme le disent les manuels d'instruction
militaire : « la discipline faisant la force principale des armées », chacun
dut s'exécuter sans délai.
Je voudrais apporter maintenant quelques précisions
sur la topographie du terrain : La Pointe de Grave, ainsi que chacun peut le
constater encore aujourd'hui est parcourue dans sa partie médiane et jusqu'à la
pointe du Verdon par une route nationale.
A gauche de cette route se déploie une voie ferrée qui
traverse une forêt de pins vallonnée. A droite de la route s'étendent des
terrains le plus souvent marécageux.
Sur la partie gauche, la forêt de pins se prolonge
presque jusqu'à la pointe de Verdon. Parallèlement à cette forêt, s'étend une
belle plage de sable d'une cinquantaine de mètres de large. Au-delà, bien sûr,
c'est la mer. Plusieurs forts construits ou aménagés par les allemands sont
dissimulés dans la forêt. Ce sont des ouvrages très importants équipés, en
outre, de canons de marine de gros calibre pointés vers le large. Un armement
moins lourd mais cependant redoutable vient compléter la défense terrestre.
L'avant dernier fort avec lequel nous aurons maille à
partir est le fort des Arros (ouvrage 307). Le dernier bastion qui sera notre
objectif final (ouvrage 305) est érigé à l'extrême pointe du Verdon. Après
cette description du terrain à conquérir, je reviendrai au récit de notre
situation.
Ce 19 avril vers 2 heures du matin, notre bataillon se
déploie sur toute la largeur de la pointe. Notre compagnie progresse prudemment
en colonne par un, à cause des nombreuses mines sur la route nationale. Des
éclaireurs partent en avant mais ne trouvent pas de contact avec l'ennemi. Nous
traversons Soulac sans encombre. A environ 1 km de cette localité, la compagnie
stoppe sa progression. L'ordre nous est donné de nous abriter dans les fossés
longeant la route. Cette halte nous permettra de prendre quelques heures de
repos bien nécessaire, car nous sommes littéralement épuisés de fatigue.
Doucement, au dessus des pins, se levait l'aube de
cette journée qui allait être pour le bataillon le baptême du feu. Vers huit
heures arrivent les chenillettes. Nous recevons, à ce moment, 60 cartouches par
homme ce qui représente le maximum de ce que nous pouvons transporter. Notre
chef de bataillon, le commandant Raynaud se porte en avant pour inspecter notre
dispositif d'attaque.
A ses côtés, se trouve l'adjudant-chef Sudre qui sera
mortellement blessé. Nous apprendrons par la suite que la 4ème compagnie (Lieutenant Didier) ayant pour objectif
la prise du hameau « Les Huttes », situé à droite de la route progressait
difficilement dans un terrain marécageux et subissait des pertes importantes.
Nous pouvions voir sur la route, le passage incessant des brancardiers
transportant les blessés, spectacle peu réjouissant. La 3ème
compagnie (Lieutenant Jandin) se trouvait au contact avec l'ennemi dès 3 heures
du matin.
A 10 heures, l'ordre d'attaque est donné, l'objectif
de notre compagnie (la 1ère) était l'approche du point 307. Au travers
des arbres apparaissait la plage, noyée de soleil, puis la mer.
Notre ligne d'attaque se déploya dans la forêt. Il
régnait en ce lieu une forte chaleur. Nous devions subir un feu intense de
l'ennemi : feux d'infanterie, tirs de mortiers, rafales meurtrières de
francs-tireurs grimpés dans les arbres.
Je me trouvais, à l'instar de mes camarades, dans un
état second ne sachant pas très bien ce qui se passait autour de moi. J'ai
cependant gardé le souvenir de quelques actes d'héroïsme. Auprès de nous, le
caporal Diger se dressait en dépit du danger et à l'aide de son
fusil-mitrailleur, balayait le rideau d'arbres pour neutraliser les tireurs
isolés, il sera grièvement blessé, notre camarade Amiot le torse ceint de
bandes de mitrailleuse « canardant » l'adversaire avec un fusil-mitrailleur
allemand à tir rapide. Dans ces mêmes instants le sergent-chef Dubois tombait
grièvement blessé entre les lignes. Il
Malgré la vive résistance de l'ennemi, notre
progression est lente mais régulière. Il faut dire que nous sommes relativement
protégés des tirs directs par le relief accidenté de la forêt. L'ennemi en
s'enfuyant, abandonnait sur le terrain un important matériel. Tout à coup, à
quelques pas de nous, éclate une fusillade d'une violence inouïe, inquiétude
générale. Mais il s'agissait seulement de l'embrasement d'un dépôt de munitions
d'infanterie atteint par l'incendie. Partout la forêt commençait à brûler, les
flammes léchaient le tronc des arbres. Il régnait là, une chaleur d'enfer. Peu
à peu, l'adversaire perdit du terrain qu'il tenta d'évacuer vers l'abri du
fort. Nous étions assez bien planqués au creux des dunes et nous tirions à vue
à 100 mètres sur l'ennemi en fuite. A mes côtés, Yves, les lunettes sur le nez
s'employait activement à brûler des cartouches.
Il y eut bien quelques confusions dans le commandement
mais chacun continuait le feu avec ardeur sans se soucier d'économiser les
munitions.
Pendant ce temps, nos brancardiers, sillonnaient les
bois et, avec courage et efficacité relevaient rapidement nos blessés. Les
chenillettes nous approvisionnaient en munitions. Le combat se poursuivait à
notre avantage malgré une cadence de tir assez lente car le magasin de nos
fusils ne contenait que cinq cartouches. Je devais souvent en essuyer la
culasse, car elle se trouvait fréquemment enrayée par le sable. Il y avait déjà
pas mal de blessés dans notre compagnie mais nous ne devrions savoir cela que
par la suite. Nous reçûmes l'ordre de creuser des tranchées à l'aide de nos
pelles-bêches pour tenter de contenir l'incendie. Notre progression vers la
plage se trouva stoppée par la ligne de chemin de fer établie en tranchée. Nous
franchirons cet obstacle sans casse malgré une mitrailleuse allemande qui
prenait la ligne en enfilade.
Cette longue et chaude journée se poursuivait
cahin-caha, non sans péril quand, vers 18 h 30, le commandant Nicolas du 1er
bataillon vint nous rejoindre accompagné d'un escadron de cinq chars « Somua ».
Ces engins d'un poids de 11 tonnes portaient un équipage de deux hommes. Ils
étaient armés d'un canon de 47 mm sur tourelle mobile et d'une mitrailleuse.
Les servants étaient des gars expérimentés du 13ème Dragon d'Orléans.
Le commandant Nicolas demanda aussitôt des volontaires
pour accompagner l'attaque des chars. L'objectif à atteindre était le fort des
Arros (ouvrage 307). Nous nous décidons tous deux ainsi qu'une vingtaine de nos
camarades pour cette ultime attaque.
Chacun se vit pourvu de munitions et de trois grenades
quadrillées (projectiles très destructeurs) puis nous reçûmes l'ordre de mettre
baïonnette au canon ce qui nous parut de mauvais augure. L'instant d'après, les
cinq chars descendirent sur la plage et se placèrent en ligne d'attaque en
direction du fort. Notre groupe se positionna derrière les engins pour
s'abriter du feu ennemi. Chaque char protégeant six à huit hommes. Le terrain
était battu par un feu meurtrier : rafales d'armes automatiques, tirs de
mortier. Le sergent-chef Agoutin qui commandait notre groupe d'assaut désigna
un caporal pour le remplacer au cas où il serait tué.
Nos cinq « Somua » portaient le nom des héros des
trois mousquetaires : Porthos, Athos, Aramis, d'Artagnan et Milady ». Je crois
me souvenir que nous étions derrière ce dernier char. Les équipages avaient
placé sur l'arrière de leurs tourelles leurs sacs de paquetage pour servir de
pare-éclats. Les chars s'avançaient en ligne puis stoppaient pour envoyer une
salve de leur canon de 47 mm. Le recul de leur pièce projetait l'engin en
arrière. Le tir était appliqué au début de l'attaque à moins de 500 mètres et
était très bien ajusté. Nous pouvions voir clairement les impacts des obus
pénétrer par les sabords à l'intérieur du fort.
Au cours de l'attaque, un éclat vint déchirer le sac
de protection à un mètre de ma tête. Réflexion du Sergent-Chef Agoutin : «
Gérard, tu m'as fait peur ». Les projectiles frappaient le sable autour de
nous. Malgré le feu de l'ennemi, notre groupe d'attaque poursuivait son avance.
Nous pouvions voir avec inquiétude se rapprocher le fort. Je pensais à ce
moment que s'il fallait en venir au corps à corps, nous ne verrions pas la fin
de cette journée car les Fritz allaient nous réserver une sacrée réception...
Des camarades tombaient blessés autour de nous et
regagnaient comme ils le pouvaient l'abri de la forêt. Le vieux Blondel
abandonna le combat, la figure en sang en se tenant les reins. Alors que nous
étions à 150 mètres du fort, l'ordre arriva de cesser le feu et de regagner la
forêt. Nous y parviendrons tous deux sains et sauf. Nous apprendrons plus tard
que le fort attaqué par la plage avait été durement touché par l'artillerie des
chars et avait en même temps été pris à revers par le bataillon de volontaires
espagnols, « Guernica ». Le commandant de l'ouvrage avait hissé le drapeau
blanc, signe de la reddition.
L'avant dernier ouvrage défensif de la pointe venait
de tomber.
Je voudrais ici citer un document historique
concernant le fort des Arros :
« Cet ouvrage ne comportait pas moins de 18 blockhaus
avec 4 pièces de 165, 2 pièces de 77 et 8 mitrailleuses à 4 tubes en ouvrage à
ciel ouvert ».
Notre tâche de la journée étant terminée, je me
permettrai de dire bien terminée, les éléments validés de notre compagnie
regagnèrent la route vers 20 heures pour y prendre un peu de repos.
Notre 3ème bataillon avait pris ce jour là
une part décisive à la bataille. Le 1er bataillon de notre régiment
n'y eut qu'une action secondaire mais il devait s'illustrer brillamment le
lendemain lors de l'attaque du fort 305. Au cours de cette journée, nous eûmes
à déplorer la perte de 96 hommes tués ou blessés soit l'effectif d'une
compagnie.
 Le
19 avril 1945, à la pointede Grave, Félix Le Liboux, blessé au pied
droit par une balle allemande est porté par deux de ses cinq prisonniers
qu’il vient de faire avec Marcel Duchon
Le
19 avril 1945, à la pointede Grave, Félix Le Liboux, blessé au pied
droit par une balle allemande est porté par deux de ses cinq prisonniers
qu’il vient de faire avec Marcel Duchon
Les services historiques des armées signalèrent la
bonne tenue au feu du bataillon F.F.I. des volontaires d'Eure-et-Loir. Voici
ici évoquée d'une façon quelque peu décousue mais exacte ce que fut pour nous
la journée du 19 avril telle que je l'ai vécue.
Pour en terminer sur ce chapitre, je dois ajouter que
de nombreux prisonniers tombèrent entre nos mains ainsi qu'un important
matériel.
Le capitaine de corvette Birnbacher chef du bataillon
Narvick et commandant du fort réussit à s'échapper, il ne sera pris que le
lendemain. Je reprendrai ici le fil de mon récit : vers 20 h, nous quittons la
forêt et parvenons sur la route. La brume du soir recouvre peu à peu la cime
des arbres. Nous essuyons encore quelques tirs d'artillerie en provenance
semble-t-il du fort 305, mais nous n'y prenons pas garde car nous commençons à
nous habituer à ce genre de situation. Là, étendus sur l'herbe, nous apaisons
un peu notre faim avec du chocolat américain. Des prisonniers portant le
brassard de la croix rouge vont et viennent sous bonne garde pour s'occuper des
blessés. Auprès de nous, un jeune soldat allemand, le front ceint d'un bandeau
rougi est en train d'agoniser. Il ne survivra que peu de temps à ses blessures.
Ceci illustre bien la cruauté de la guerre. Puis les chefs de section nous
distribuent de l'huile pour nettoyer nos armes qui en avaient bien besoin. La
nuit tombe sur cette longue journée. Nous nous restaurons de conserves
américaines, arrosées de vin tiède, puis trouverons rapidement le sommeil qui
sera malheureusement troublé par d'infernales nuées de moustiques.
Nous aurons, le lendemain, quelques nouvelles sur
l'engagement au combat des autres compagnies de chez nous. Nous apprendrons que
le lieutenant Jandin qui dirigeait la 3ème compagnie avait été par
trois fois blessé et était retourné au combat pour assurer son commandement.
Notre camarade le caporal chef Lorigny de la 4ème compagnie qui
attaquait dans le secteur « Les Huttes » fit avec sa section quatre prisonniers
avant de tomber dans les marais grièvement blessé. Il fut recueilli par ces
quatre types qui l'emmenèrent au fort où il fut soigné et opéré par un
chirurgien allemand, cet acte de générosité mérite un coup de chapeau.
Au matin de ce jour (20 avril), la progression
reprenait en direction du Verdon. Une colonne de chars Scherman stationnait sur
la route. La configuration du terrain boisé et vallonné ne permettait pas à ces
gros engins de prendre une part active pour réduire les dernières défenses de
l'adversaire. Cela ne pouvait être que l'affaire de l'infanterie.
Ici document historique :
« Dans le secteur du groupement Reverdy, un élément se
glissait le long du rivage, atteignait la pointe de Grave et s'en emparait sans
difficulté à 13 heures. Mais les éléments du 1/131ème axés sur la route se
heurtaient à l'ouvrage 305 implanté autour du sémaphore du Verrier-St-Nicolas.
Le 3/131ème (le nôtre) était également gêné
dans sa progression par des tirs de mitrailleuse venant de l'ouvrage et
appliqués à 600 mètres »
Notre avance étant bloquée par ces tirs, nous reçûmes
l'ordre de repli à une distance de 500 mètres et de nous abriter dans les
fossés. Une escadrille des forces aériennes françaises opéra un bombardement en
piqué de 18 h à 18 h 15. Joli spectacle car nous étions aux premières loges.
Les chasseurs bombardiers dans un ballet bien réglé piquaient à tour de rôle
sur l'objectif, leurs mitrailleuses d'ailes crachant le feu, puis à très basse
altitude, lâchaient leurs bombes, qui miroitant un instant dans le soleil,
allaient s'écraser avec une précision extraordinaire sur les défenses du fort.
D'épaisses colonnes de fumée s'élevèrent au dessus de la cime des arbres.
Ces appareils des « S.D.B. » étaient des bombardiers
monomoteurs de 1.200 C.V. spécialement conçus pour le bombardement en piqué, avec
comme équipage le pilote et le mitrailleur bombardier. Ils étaient armés de
mitrailleuses fixes de 12 mm ainsi que de deux mitrailleuses Browning de 9 mm
servies par le mitrailleur.
Une bombe de 1.000 livres et des Clusters (fusées)
sous les ailes complétaient l'armement.
Ici document historique :
« Dès la fin du bombardement le l/131ème qui
s'était glissé à l'est du 305 pour attaquer de flanc, partait à l'assaut. Les
sections Bridoux des 1er et 2ème compagnies ainsi
qu’un groupe franc du PC du bataillon réussissaient à s'infiltrer et,
après un combat au corps à corps dégageaient le passage du bataillon. A 19 h
30, la position était occupée et le 1/131ème faisait 137 prisonniers
dont le capitaine de corvette Birnbacher.
La dernière résistance de la pointe de Grave venait de
tomber. Les accès du port de Bordeaux étaient dégagés »
Les combats ayant cessé, la journée du 21 avril fut
une journée de repos, ce qui nous permit d'aller visiter le fort 305. Cet
ouvrage avait été dévasté par l'attaque aérienne de la veille. Des cadavres
allemands gisaient sur les pentes du fort. Une pièce de D.C.A. avait été
touchée par une bombe, ses servants ayant été tués par l'explosion. L'attaque
aérienne avait été décisive. Nous parvint alors, la nouvelle que le lendemain
22 aurait lieu une importante prise d'armes au terrain d'aviation de Grayan en
présence du général de Gaulle.
Chacun des régiments ayant participé aux combats y
serait représenté par une compagnie.
Nous fûmes désignés tout deux par le sergent-chef
Agoutin (dit Glou-Glou) pour faire partie de cette compagnie en raison
paraît-il, de notre bonne tenue au combat.
Ce jour-là, des camions nous transportèrent jusqu'à
Grayan. Des prisonniers sous bonne garde s'employaient à orner le terrain de
drapeaux. Vers 14 heures, les compagnies se formèrent en bon ordre et prirent
place sur le terrain. L'attente nous parut longue sous un chaud soleil. Enfin,
vers 15 heures, un Piper-Cub (avion léger d'observation) vint survoler le
terrain à très basse altitude et chacun put reconnaître la silhouette du
Général. Peu de temps après la cérémonie débutait par la remise des
décorations. Le sergent-chef Tachet de la 3ème compagnie, un gars de
chez nous reçut des mains du Général, la médaille militaire.
Celui-ci, accompagné de nombreux officiers supérieurs
se fit présenter chacune des unités combattantes. Il devait avoir là plus d'un
millier d'hommes. A notre droite se trouvait le bataillon des Somalis. Quelques
instants plus tard, le colonel Durand, sur un ordre bref, nous faisait mettre
au « présentez armes ». Le Général était devant nous.
Quelle n'était pas notre fierté alors de saluer ainsi
l'homme du 18 juin. Après tant d'années passées, nous en gardons encore
aujourd'hui un souvenir ému. Puis ce fut, sur le front des troupes, le défilé
d'une musique militaire en grande tenue, guêtres et baudriers blancs, jouant la
marche lorraine.
Ainsi se terminait cette mémorable journée. Le soir
même, le bataillon vint nous rejoindre et reçut l'ordre de bivouaquer en face
du terrain de Grayan. Des feux de camps furent allumés et, malgré notre
fatigue, la soirée se termina joyeusement par des chansons car le vin et le
café ne manquèrent pas.
 22
avril 1945. Le Général de Gaulle décore le Sergent-chef TACHET (3ème
Cie).
22
avril 1945. Le Général de Gaulle décore le Sergent-chef TACHET (3ème
Cie).
Avant d'en terminer sur ce chapitre, je tiens à citer
l'ordre du jour que le Général de Larminat adressa aux troupes : :
« En sept jours de combat, les forteresses de Roy an
et de la pointe de Grave ont été conquises.
10.000 prisonniers ont été faits. De nombreux ennemis
jalonnent de leurs cadavres les puissantes fortifications du mur de
l’Atlantique d'où elles barraient les accès du port de Bordeaux.
La bataille a été rude, car l'allemand s'est défendu
âprement sans esprit de recul ni de capitulation.
Elle a été victorieuse parce que les troupes du corps
d'attaque ont combattu avec courage, intelligence et cohésion.
Les unités d'origine F.F.I. ont étonné leurs anciens,
non pas par leur ardeur que l'on connaissait mais par leurs qualités
manœuvrières et leur sang-froid de vieille troupe.
Tout cela a bien marché parce que tout le monde s'est
battu avec tout son cœur en ne pensant qu’à son pays. C'est une
belle leçon dont nous ne perdrons pas le sens.
Soldats, aviateurs, marins, vous pouvez, être fiers de
votre œuvre.
Vous avez, bien mérité de la Patrie.
Général de Larminat, commandant le corps
d'attaque »
Peu de temps après notre régiment aura l'honneur
d'accrocher à son drapeau la croix de guerre avec étoile de bronze.
Le lendemain, nouveau déplacement de notre unité en
convoi ferroviaire vers Bourcefranc, Le Chapus, en face de l'île d'Oléron ;
seul territoire encore occupé par l'ennemi. Les compagnies seront cantonnées
dans une école maternelle et passeront là quelques jours paisibles. Les sorties
en ville étaient l'occasion de dégustation d'huîtres (nous sommes près de
Marennes) et de pineau. Notre compagnie se vit confier la garde du bord de mer.
Les avant-postes de fusils-mitrailleurs étaient enterrés et assez bien
aménagés. Notre groupe (sergent Legrand) prit possession de la villa « Les
Dunes » située à proximité de la mer.
Nous y coulerons des jours tranquilles avec l'avantage
de dormir sur des matelas ce qui ne nous était pas arrivé depuis trois mois. On
nous distribua à nouveau du ravitaillement français que la chenillette nous
apportait chaque matin. Ce n'était pas bien fameux, mais cela nous changeait
des rations américaines dont chacun était absolument dégoûté.
Je me proposais alors comme cuistot du groupe et
m'efforçais de préparer le mieux possible la nourriture qui nous était allouée.
Mes clients ne se plaignaient pas trop de l'ordinaire que nous parvenions à
améliorer en allant visiter une ferme de l'arrière. Les fermiers nous
recevaient gentiment et nous procuraient de temps à autre du lait frais et
quelque fois du beurre, denrée au combien précieuse à cette époque, pour
améliorer les « fayots » de l'intendance.
La chenillette nous apportait chaque jour un petit fût
de vin que nous mettions en batterie sur le siège des WC. Certains
fréquentaient cet endroit avec une belle régularité... De temps en temps
l'ordinaire était amélioré grâce à l'arrivée d'un panier d'huîtres. C'était
alors un vrai régal car cette nourriture fraîche et fortifiante nous faisait le
plus grand bien.
Un puits était creusé dans le jardinet de la villa
mais il nous délivrait une eau saumâtre à cause de la proximité de la mer, ce
qui donnait au café un goût bizarre. Les tours de garde recommençaient dans la
position F.M. au bord de la mer. L'île d'Oléron était là, toute proche mais
encore occupée par les allemands. Le secteur était tranquille, quelquefois
ponctué de tirs d'artillerie. Nous passerons là quelques jours, de presque
vacances.
Enfin arriva le jour de l'offensive contre l'île. Au
petit matin, se déclencha une préparation d'artillerie, prélude de l'attaque.
N'étant pas de garde à ce moment, je m'en vais avec Yves rendre visite à un
poste d'observation situé au bord de la mer. De cet endroit, nous pouvions
observer le débarquement à l'aide de jumelles binoculaires obligeamment prêtées
par les artilleurs. On pouvait suivre très nettement la progression des engins
amphibies, qui, traversant le bras de mer, allaient débarquer leurs troupes sur
l'île. La résistance allemande fut faible et Oléron fut rapidement conquise.
Les attaques de Royan, de la pointe de Grave et de
l'île d'Oléron ont été une parfaite réussite des forces françaises ainsi qu'en
font foi les documents historiques.
Les moyens mis en œuvre pour ces opérations ont
été particulièrement puissants et bien coordonnés grâce à l'action simultanée
de la marine, de l'aviation et des forces terrestres, appuyées par une
puissante artillerie et des blindés.
Ceci a permis une victoire rapide avec un minimum de
pertes en vies humaines malgré la détermination de l'adversaire.
Notre séjour en villa au bord de la mer s'achevait.
Arriva l'ordre au bataillon de gagner Marennes pour s'installer dans une
caserne située à l'extérieur de la ville. L'arrivée en cet endroit ne nous
souriait guère car c'était à nouveau les corvées, les factions et aussi une
certaine contrainte.
Cependant, les nouvelles étaient bonnes. Le IIIème
Reich voyait se termine dans les ruines de Berlin sa lente agonie. La victoire
était proche. Une partie de la caserne était occupée par de nombreux
prisonniers que nous devions garder et faire travailler. Heureusement après la
soupe du soir, quartier libre nous était accordé ce qui nous permettait d'aller
en ville, accompagnés de nos amis Gilbert et Pierre pour vider ensemble
quelques verres de pineau et de vin du pays.
Les bruits d'armistice se précisaient. Enfin, le 7 mai
le premier acte de capitulation sans condition de l'Allemagne nazie était signé
à Reims.
Une compagnie du bataillon fut désignée pour
représenter le régiment à Orléans, ville d'origine du 131ème. Nous
avons la joie d'apprendre que nous serions du voyage. Le 7, c'est le départ par
le train à la gare de Saintes, puis l'arrivée à Orléans après un long voyage de
nuit. Au petit matin notre détachement, fort d'une centaine d'hommes, gagna en
bon ordre la caserne Coligny située dans le faubourg Bannier. Un peu plus tard,
on nous infligea une séance de maniement d'armes préparatoire. Après le
déjeuner, eut lieu le départ, l'arme à l'épaule, en direction de la place du
Martrois.
Nous défilerons seuls derrière une musique militaire.
Dans les rues la foule est nombreuse et enthousiaste. Sous les acclamations du
public, nous prenons place en tant que compagnie d'honneur pour assurer la
garde des drapeaux au pied de la statue de Jeanne qui fut en d'autres temps la
libératrice de la patrie. Nous resterons là au garde à vous pendant plus de
deux heures. Les troupes françaises et américaines passaient devant nous, en
saluant les drapeaux avec leurs musiques militaires.
Troupes françaises de diverses armes, passages
d'avions dans le ciel, grondement des blindés qui, venant de la rue Royale,
faisaient pivoter leurs chenilles pour contourner la place et remonter la rue
de la République. Ce fut un magnifique défilé qui célébra avec faste cette
journée de liesse et de victoire.
Peu de temps après notre retour à Marennes, j'appris
que les permissions étaient rétablies, elles avaient été, pour moi, si
longtemps différées.
Le 23 mai, je reçois enfin ma feuille de route. Vers
15 heures, je me poste avec quelques camarades sur la route de Saintes. Un
brave automobiliste (ils sont rares à cette époque) nous prend à son bord pour
nous conduire à la gare de cette ville. Un train de nuit nous conduira à Paris
où nous débarquons au petit matin.
Puis, c'est le métro, la gare Montparnasse, enfin le
train roule vers Chartres. Au-dessus des premières maisons de la ville apparaît
notre cathédrale. Malgré la fatigue du voyage, je remonte rapidement l'avenue
de la gare. Quelques minutes plus tard, je me trouvais au milieu des miens.
Après une semaine de repos, mon état de santé ne s'étant
pas amélioré, mon père me conseilla de me présenter à l'hôpital militaire de
Chartres. J'y serai examiné par le commandant major qui m'accordera une
permission de maladie 30 jours. A l'expiration de ce délai, aucun changement
n'étant intervenu à mon état, je serai convoqué, le 29 juin devant une
commission spéciale des services de santé de l'armée.
Après un examen sommaire de mon cas, je serai réformé
pour grave maladie pulmonaire. Ainsi se terminait ma brève carrière militaire.
Au début du mois de juin, le bataillon reçut l'ordre
de faire mouvement vers l'Est, plus précisément sur la frontière
Luxembourgeoise. En cet endroit, il sera affecté à plusieurs tâches, notamment
à la garde et à l'encadrement de prisonniers. Puis, au début de l'automne, il
sera dissout. Ainsi se terminait la brève épopée du bataillon des volontaires
d'Eure-et-Loir. Bien des années ont passé depuis la fin de cette guerre, mais
je garde encore aujourd'hui, un vif souvenir de cette courte période de ma vie
et aussi, je dois l'avouer, une certaine fierté d'avoir servi dans les rangs du
1er bataillon.
En effet, il règne dans les unités de ce type un état
d'esprit assez exaltant qui va dans le sens du devoir et du sacrifice librement
consenti.
La guerre étant terminée chacun fut repris par les
nécessités de la vie civile. L'existence et l'action du 1er
bataillon tombèrent dans l'oubli. Il aura fallut la rencontre fortuite, il y a
une dizaine d'années, de quelques camarades pour que se crée une amicale des
anciens de notre unité. Cette heureuse initiative nous donne désormais
l'occasion de nous retrouver fréquemment autour de notre drapeau marqué du loup
protégeant la croix de Lorraine dans une ambiance de camaraderie et de
fraternité.
Une rue à Chartres, une place à Dreux, une autre à
Châteaudun perpétue désormais le souvenir des volontaires d'Eure-et-Loir.
Il convient bien sûr, de se replacer dans le contexte
de cette époque pour comprendre ces événements. Je crois qu'il est nécessaire
de rappeler que notre pays avait dû subir pendant quatre longues années les
rigueurs d'une impitoyable occupation. La France était humiliée, affamée, en
partie détruite. Elle avait porté le deuil de ses résistants et de ses déportés
torturés et exécutés par les Nazis. C'est pour ne plus revoir cela que chacun
doit souhaiter aujourd'hui que la construction de l'Europe, préconisée et
entreprise par le Général de Gaulle, puisse malgré les difficultés,
prochainement aboutir pour assurer aux générations futures une ère de paix
juste et durable.
Je ne saurais terminer ce simple récit sans avoir une
pensée émue pour les combattants volontaires morts pour la France. Je pense à
ceux de la France Libre qui combattirent sous le soleil d'Afrique sous les
ordres de l'intrépide général Leclerc et s'illustrèrent brillamment à Bir
Hakeim.
A ceux de la résistance qui luttèrent vaillamment et
parmi les plus grands périls sur les arrières de l'ennemi. A ceux aussi, qui,
sous le commandement du général Juin, vécurent les terribles combats du mont
Cassino et ceux de la 1ère armée qui, avec leur chef le général de Lattre
de Tassigny débarquèrent à Toulon, remontèrent la vallée du Rhône puis
passèrent le Rhin pour porter nos couleurs victorieuses jusqu'à Berchtesgaden.
Pour tous ceux là et aussi pour nos camarades d'Eure-et-Loir,
je tiens à citer cette parole du Général de Gaulle :
Le général de Boissieu, son gendre (d'origine
chartraine) rapporte cet émouvant témoignage que de Gaulle écrivit en
Grande-Bretagne à la mémoire de ceux qui avaient donné leur vie pour la liberté
et la France : « 0 mon dieu donne à chacun sa propre mort, dit l'auteur du
livre de la pauvreté et de la mort. A ceux qui ont choisi de mourir pour la
cause de la France sans qu'aucune loi humaine les y contraignit, à ceux là,
Dieu a donné la mort qui était propre, la mort des martyrs »
Jacques
Gérard
Croix
du Combattant Volontaire 39/45
2005
PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS de la GUERRE
1 septembre 1939 Invasion de la Pologne par l'Allemagne
Déclaration
de la guerre
10 mai 1940 Attaque allemande. Percée de Sedan
Rupture
du front français
18 juin 1940 Appel du général de Gaulle à Londres
Constitution
de la « France Libre »
22 juin 1940 Armistice de Pétain à Rethondes
Juillet 1940 Bataille d'Angleterre
Raids massifs
de la Luftwaffe
22 juin 1941 Invasion de l'URSS par l'Allemagne
7 décembre 1941 Attaque japonaise contre Pearl Harbor
Entrée
en guerre des Etats-Unis
Juin 1942 Victoire des Français Libres à Bir Hakeim
Novembre 1942 Défaite de Rommel à El-Alamein
Débarquement
allié en Afrique du Nord
Occupation
de la Zone Libre
Sabordage
de la flotte française à Toulon
1943 Défaite allemande à Stalingrad
Débarquement
allié en Sicile
1944 Bataille d'Italie (Cassino)
Prise de
Rome
6 juin 1944 Débarquement en Normandie
15 août 1944 Débarquement à Toulon de la première armée française
(Général
de Lattre de Tassigny)
25 août 1944 Libération de Paris
30 avril 1945 Prise de Berlin par les Russes
7 mai 1945 Armistice à Reims
Capitulation
sans condition de l'Allemagne
8 mai 1945 Signature définitive de l'Armistice à Berlin
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS
S.T.O. : Service du travail obligatoire en Allemagne imposé par
l'occupant
B.B.C. : Chaîne de radio anglaise diffusant des informations en
français
F.F.I. : Forces Françaises de l'Intérieur
F.T.P. : Francs-tireurs et partisans d'obédience communiste et
Groupements
de
résistance clandestins combattants sur les arrières de l'ennemi
P.C. : Poste de commandement
F.M. : Fusil-mitrailleur
E.M. : Etat-major
D.A.A. : Direction attaque aérienne
R.A.F. : Royal Air Force (aviation de combat
britannique)
D.C.A. : Artillerie de défense contre avions
S.D.B. : Avions de bombardements moyens à basse altitude
WEHRMACHT : Forces terrestres allemandes
LUFTWAFFE : Aviation de guerre allemande
DOCUMENTS HISTORIQUES
Le front du Médoc
La brigade Carnot au combat
Presse U.F.I.



